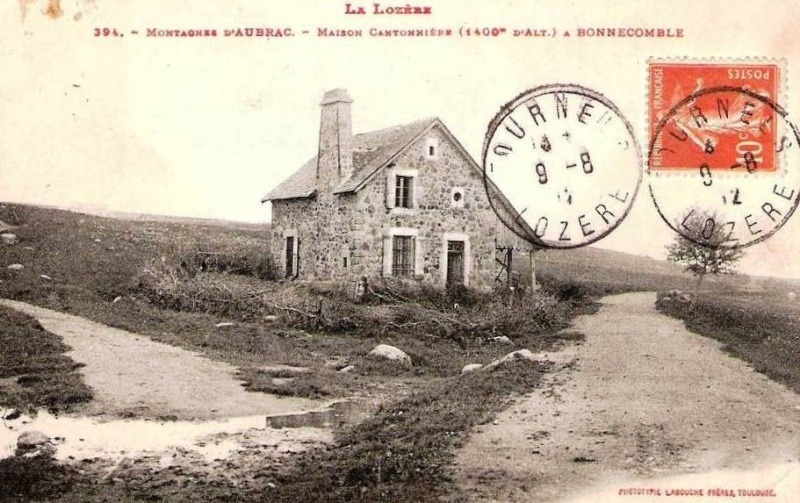-
Compteur de contenus
333 -
Inscription
-
Dernière visite
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Nyko
-
PARIS (Reuters) - Malgré le retour des pluies début juillet, la sécheresse s'est intensifiée en France où 28 départements sont touchés par des mesures de restrictions de l'usage de l'eau, annonce un bulletin hydrologique publié mardi par le ministère de l'Ecologie. Ces restrictions, qui s'appliquent surtout au secteur agricole, sont en vigueur dans les départements situés dans les bassins du Poitou-Charentes, de l'Adour-Garonne, du Nord et dans la région Rhône-Alpes, précise le ministère. Il s'agit notamment des départements de l'Ain, de l'Aisne, du Cher, de l'Eure, de la Seine-Maritime, des Vosges, de l'Ardèche, de la Loire-Atlantique, de Charente-Maritime, des Landes, de la Lozère et du Tarn-et-Garonne. Les restrictions de prélèvements de l'eau y sont de l'ordre de 15 à 30 %, voire "plus pénalisantes" sur certains petits bassins du Poitou-Charentes, précise le ministère. "Ces restrictions pourraient être renforcées prochainement en l'absence de précipitations significatives", ajoute-t-il, n'excluant pas de les étendre à d'autres secteurs que l'agriculture. En cas de "nécessité", des limitations sont en effet prévues dans une vingtaine d'autres départements dont les Yvelines, l'Essonne, la Seine-et-Marne, l'Oise, l'Eure-et-Loir, les Alpes-Maritimes, les Alpes de Hautes-Provence et l'Hérault. Depuis début avril, les précipitations ont "presque partout, été inférieures à la normale", explique le ministère, qui fait état sur la moitié Est du territoire d'un déficit pluviométrique de 25 à 50%. Dans le Sud-Est, il a parfois dépassé 50%. En juin, la situation a empiré "presque partout", a l'exception de la Corse. Le déficit pluviométrique a été "particulièrement marqué" sur la moitié sud de la France et plus particulièrement dans le Sud-Ouest et la basse vallée du Rhône où il a été de 75 à 100 %, constate les auteurs du bulletin. "Les sols sont beaucoup plus secs que d'habitude. On note ainsi un déficit général des réserves utiles des sols qui s'est étendu à l'ensemble du territoire, excepté dans les Alpes", précisent-ils. Début juillet, les nappes souterraines présentaient des niveaux inférieurs aux normales saisonnières. Toutefois, le taux de remplissage des barrages reste "satisfaisant", les pluies des premiers jours de juillet ayant apporté "un répit temporaire". "La gestion des stocks doit être faite avec prudence pour pouvoir faire face au risque d'une sécheresse prolongée jusqu'à l'automne et au probable décalage de la campagne d'irrigation dans certaines régions", précise le bulletin.
-
MONTEVIDEO - Au moins 23 personnes sont mortes à la suite d'une vague de froid qui touche depuis plusieurs jours six pays d'Amérique latine. Des températures quasi-polaires sont accompagnées de fortes pluies et de chutes de neige. L'hiver est particulièrement rigoureux dans l'hémisphère sud et ce week-end des pays tels l'Argentine, le Brésil, le Chili, l'Uruguay, le Paraguay et le Pérou ont connu les températures les plus basses enregistrées au cours des dix dernières années. Au Pérou, où plus de 100 000 personnes souffrent du froid, Lima a fait distribuer 34 tonnes de couvertures et de vêtements chauds ainsi que des médicaments pour les populations vivant au-dessus des 4000 mètres. Officiellement, le froid a déjà tué au moins 18 enfants de moins de cinq ans dans les Andes. En Argentine, la vague de froid a tué cinq personnes et provoqué des chutes de neige dans des zones inhabituelles comme la station balnéaire de Mar del Plata, à 400 km au sud de Buenos Aires. En Terre de Feu, le thermomètre est descendu à -11 degrés. Le sud du Brésil connaît lui aussi les températures les plus basses de ces dix dernières années. A Sao Joaquim, dans l'Etat de Santa Catarina, le thermomètre est descendu dimanche à -7 degrés et à Las Palmas dans le Parana, à -3. En Uruguay, environ 2000 personnes bénéficient du "plan hiver" mis en place par le gouvernement et la ville de Montevideo pour héberger les sans domicile fixe. Les autorités du Paraguay ont mis en congé tous les élèves en prévision des basses températures et gelées très inhabituelles prévues jusqu'à mercredi. © ATS
-
Particulièrement active dans une partie du canton de Luzy,une véritable mini tornade a tout emporté sur son passage ce mercredi 7 juillet aux environs de 14 h. Empruntant un secteur allant de la commune d'Avrée jusqu'à Chiddes, déployant sa largeur sue environ 700 m, l'effet de souffle et de grêle mélangé ont eu raison de nombreuses toitures et arbres. A Avrée notamment, le chapiteau dressé pour les fêtes de l'été fut complètement renversé par une bourrasque qui n'a duré que deux minutes environ. A Chiddes quelques km plus loin le scénario était le même avec une force peut être multipliée là où les toitures de la mairie et de l'école ont souffert de même que de nombreux arbres déracinés. Lignes téléphoniques, électriques ont également été endomagées occasionnant de nombreuses coupures. Rapidement sur les lieux,sapeurs pompiers,agents EDF et Télécom ont réalisés un excellent travail de remise en route de tous les réseaux. © Copyright Le Journal de Saône et Loire
-
-
L’une des menaces les plus fortes qui pèsent sur notre environnement terrestre est le réchauffement du climat. Au cours du XXe siècle, la température moyenne à la surface de la Terre a augmenté de plus de 0,6 degré. Depuis 1975, le rythme de la hausse de la température s’accélère, et les années les plus chaudes ont été observées au cours de la dernière décennie, l’année record étant pour l’instant 1998. Il existe bien d’autres signes montrant que le climat se réchauffe, par exemple la montée du niveau des océans et le recul des glaciers continentaux au cours du XXe siècle. À quoi est dû ce réchauffement récent du climat ? Il provient de composés gazeux très minoritaires de l’atmosphère : les gaz à effet de serre. On désigne ainsi des gaz qui sont transparents au rayonnement solaire, mais absorbants pour le rayonnement infrarouge émis par la Terre. Cette propriété leur confère un pouvoir de chauffage de la basse atmosphère, pouvoir naturel et bénéfique au départ. Hélas, la teneur atmosphérique de certains de ces gaz, tels le dioxyde de carbone (CO2) ou le méthane (CH4), augmente depuis le milieu du XIXe siècle et cette augmentation va s’accélérant, en liaison avec l’industrialisation et la poussée démographique des sociétés modernes. Il en résulte un effet de serre additionnel, d’origine humaine, qui contribue à réchauffer progressivement la basse atmosphère. La plus grosse part provient du dioxyde de carbone, émis par les activités impliquant la combustion des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel). Comment les scientifiques sont-ils pratiquement certains que l’effet de serre additionnel est la cause du réchauffement récent du climat ? En fait, même s’il existe d’autres facteurs, naturels cette fois, pouvant faire varier la température à la surface de la Terre, c’est le seul facteur capable d’expliquer l’amplitude et les caractéristiques du réchauffement observé. Les scientifiques l’ont montré à l’aide de modèles climatiques fonctionnant sur d’énormes calculateurs et capables de reproduire la complexité du système terrestre et les interactions entre ses composantes (l’atmosphère, l’océan, les glaces, les sols et la végétation). Grâce à ces modèles climatiques, on peut également évaluer l’impact des émissions de gaz à effet de serre sur le climat des prochaines décennies. Pour une simulation reposant sur un scénario " moyen " d’émissions de gaz à effet de serre, la température moyenne continue à augmenter, pour atteindre en 2100 une valeur supérieure d’environ 3 degrés à la valeur actuelle. Pour bien se représenter cette augmentation de 3 degrés, il faut revenir très en arrière dans le temps, à l’époque des grandes glaciations et déglaciations qui ont marqué l’ère quaternaire. L’écart de la température du globe entre une ère glaciaire froide et une ère interglaciaire chaude n’était alors que d’environ 5 degrés ! Même si les simulations du climat futur comportent une part importante d’incertitude, l’ampleur du réchauffement annoncé et la vitesse à laquelle il doit s’opérer impliquent des risques notables pour les écosystèmes, pour la biodiversité et pour les sociétés humaines. Face à ces risques, il importe d’agir sans plus attendre pour limiter les émissions anthropiques de gaz à effet de serre.
-
Réchauffement climatique : trop tard ?
-
Le réchauffement climatique plus rapide que prévu selon des experts américains
-
Les pluies hivernales ont regonflé les réserves selon l'Observatoire de l'eau
-

Turquie: tornade dévastatrice près d'Ankara
Nyko a répondu à un sujet de Nyko dans Le temps en France
Souppes-sur-Loing (Seine-et-Marne) : Une tornade ravage le parc animalier -
Une tornade a fait trois morts et quatorze blessés dans la bourgade turque de Cubuk, à 50 kilomètres au nord d'Ankara. Selon des médias turcs, deux jeunes enfants figurent parmi les victimes de ce phénomène très rarement observé en Turquie. La télévision a montré des images de bâtiments endommagés, d'arbres déracinés et de véhicules renversés. "C'est comme si une bombe avait explosé dehors. Je n'avais vu cela qu'au cinéma", a raconté un habitant cité par l'agence de presse anatolienne.
-
Superproduction aux accents hollywoodiens, le film «The day after tomorrow» fait la part belle aux effets spéciaux. Et veut sensibiliser le public aux conséquences du réchauffement climatique. Avec un impact durable? Jean-François Fauconnier est spécialiste du réchauffement climatique chez Greenpeace. Il nous livre son opinion quant à l'impact que pourrait avoir le film «The day after tomorrow» sur le public, mais aussi sur la validité des théories qui y sont développées. Un tel film peut-il contribuer à sensibiliser le grand public au problème du réchauffement climatique? Ce que j'espère, c'est qu'effectivement il contribuera à rendre les gens conscients des dangers potentiels des changements climatiques. Certains articles de journaux américains affirment que «Jurassic Park» a permis d'éveiller les gens par rapport à l'ère où les dinosaures étaient encore présents sur la planète, même si là aussi des libertés par rapport à la réalité scientifique ont été prises. Donc j'espère que nous allons bénéficier du même effet pour le réchauffement climatique. Et vu qu'il s'agit d'un film américain, j'espère surtout que cela aura un grand impact là-bas, dans la mesure où les Etats-Unis sont le pays où est menée la pire politique en matière de lutte contre les changements climatiques. Parce que leur gouvernement nie tout bonnement qu'il s'agit d'une réalité et parce que parmi les responsables de ces changements, on trouve des compagnies pétrolières, Esso en tête, qui n'hésitent pas à financer des études scientifiques tendancieuses pour remettre en cause cette réalité. Or, il faut savoir que plus de 2000 scientifiques rassemblés au sein du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat aux Nations unies (le Giec) affirment d'une part que la planète est en train de se réchauffer - et ça, personne ne peut le nier, c'est mesurable - et d'autre part que ce réchauffement est dû à l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre qui renforcent l'effet de serre naturel. Une augmentation due aux activités humaines et, en particulier, à la combustion de pétrole, de gaz et de charbon. Il n'y a plus de doute de ce côté-là. On dit parfois que les changements climatiques sont des événements cycliques, qui se sont déjà produits dans le passé. C'est vrai, mais jamais dans l'histoire de l'Humanité on n'a assisté à un réchauffement aussi rapide, et c'est bien là le problème. Pensez-vous que la prise de conscience sera durable? Il n'y a pas que le film. De manière quasi quotidienne, on reçoit des informations, en provenance d'un peu partout dans le monde, d'impacts liés aux changements climatiques. Mais ce qui est important au niveau des gouvernements et d'associations comme Greenpeace, c'est de ne pas laisser les gens dans les semaines et les mois qui vont suivre avec l'impression qu'il est trop tard pour agir, qu'on va à la catastrophe et qu'on ne peut de toute façon rien faire. On va donc continuer à communiquer sur les solutions. Il est important de dire que ce film, c'est de la science-fiction, mais que les changements climatiques sont déjà une réalité et qu'il y a encore moyen d'agir maintenant pour empêcher une catastrophe qui, selon les scénarios envisagés par le Giec, prendra une autre forme que ce qui est montré dans le film. Quelle est justement la validité scientifique des théories qui y sont avancées? Les hypothèses du film ne sont pas idiotes, mais la rapidité avec laquelle certains phénomènes se déroulent relève de la pure science-fiction. L'histoire est basée sur une hypothèse en particulier qui est l'arrêt du Gulf Stream, ce courant marin qui amène des eaux plus chaudes dans l'Atlantique Nord et auquel on doit notre climat hivernal relativement tempéré ici en Europe. Or, d'après les études scientifiques, le Gulf Stream est effectivement en train de se ralentir et pourrait être freiné ou bloqué par des apports d'eau douce. S'il fait suffisamment chaud pour faire fondre une grande partie de la glace du Groenland qui est composée d'eau douce plus froide, cela pourrait freiner en partie ou bloquer complètement ce courant chaud, ce qui paradoxalement conduirait à un refroidissement en Europe. C'est une hypothèse mais aucun des modèles mathématiques ne montre un arrêt du Gulf Stream pour le siècle actuel. Le scénario le plus pessimiste étant 2100. Comment se traduirait réellement un tel refroidissement? L'hypothèse la plus probable est que l'on observe chez nous un climat hivernal semblable à celui du Canada ou du nord-est des Etats-Unis (des températures en hiver vers - 20, -30). L'impact serait déjà énorme. A ma connaissance, les Etats-Unis ou le Canada ne seraient pas directement concernés puisque c'est notre climat qui est influencé par le Gulf Stream. © La Libre Belgique 2004
-
FUNAFUTI, Tuvalu (AP) - Rivage grignoté, îlots engloutis, inondations... le réchauffement climatique lié aux gaz à effet de serre fait déjà planer une menace tangible pour les îles du Pacifique avec l'élévation du niveau de la mer. Les températures grimpent, les glaciers fondent, l'eau des océans monte et la menace climatique se précise. "Nous voyons peut-être déjà dans l'incidence accrue de la sécheresse, des inondations et des épisodes climatiques extrêmes (...) une partie des dévastations qui nous attendent", a averti en mars le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan. A cette occasion, il a appelé tous les Etats à ratifier le protocole de Kyoto conclu en 1997 pour réduire les émissions de "gaz à effet de serre" jugées responsables du réchauffement. Les Etats-Unis ont rejeté cet accord, au motif qu'il risquait de brider son moteur économique. Désormais seule sa ratification par la Russie peut relancer le traité, et l'année 2004 devrait être cruciale dans le débat sur la lutte contre le réchauffement. Sur le plan scientifique, les signes inquiétants s'accumulent. Le taux de dioxyde de carbone, qui est produit par la combustion des énergies fossiles, notamment par les voitures, a atteint un niveau record dans l'atmosphère l'hiver dernier, a rapporté en mars un observatoire d'Hawaï. En avril, des scientifiques américains ont annoncé, sur la base de relevés satellite de la Nasa, que la température moyenne à la surface de la terre avait augmenté de 0,43 degré entre 1981 et 1998. Ce qui renforce les résultats de relevés au sol, faisant état d'une élévation du mercure de 0,6 degré au 20e siècle. Ces chiffres vont également dans le sens de l'analyse du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), un organisme sous l'égide de l'ONU. Si les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas réduites rapidement, la température pourrait gagner 5,8 degrés d'ici la fin du siècle, avertit le GIEC. Si l'homme se décide à réagir face à la menace, la hausse pourrait être alors seulement de 1,4 degré, selon ces chercheurs. Le réchauffement pourrait changer le climat de régions entières et avoir de multiples effets comme des tempêtes plus violentes, une propagation de certaines maladies et une hausse du niveau des océans de 9 à 88 centimètres d'ici 2100, souligne le GIEC. L'élévation des océans est liée à deux facteurs: leur dilatation causée par le réchauffement et la fonte des glaces sur les continents. Le niveau des océans aurait gagné en moyenne 1 à 2 millimètres par an au cours du 20e siècle. Mais des satellites montrent que la hausse s'est "fortement accélérée" à 3 millimètres par an, souligne Walter Munk, de l'Institut d'océanographie Scripps à San Diego. Les habitants des îles du Pacifique ne sont pas les seules victimes potentielles du phénomène, qui représente également une menace pour de nombreuses populations dans le monde. Mais ils apparaissent particulièrement vulnérables. En outre, certaines îles de la région s'affaissent sous leur propre poids, ce qui aggrave leur situation. A Funafuti, un atoll à fleur d'eau, capitale de l'archipel des Tuvalu, la mer grignote le rivage et s'infiltre sous le sable pour créer de petits lacs dans les terres, et les fortes marées sont de plus en plus fréquentes, provoquant des inondations. Un îlot inhabité a même disparu sous les vagues. "Il a coulé lors d'un cyclone en 1997", selon le météorologue Hilia Vavae. Kiribati, un autre micro-Etat du Pacifique, a également perdu un îlot sur son principal atoll de Tarawa. A Majuro, la capitale des îles Marshall, la montée de la mer a déraciné des dizaines de cocotiers. A Kosrae, en Micronésie, "personne ne se souvient avoir vu des marées aussi fortes", note Simpson Abraham, un responsable local, et plusieurs îlots situés au large ont disparu. Aux Tuvalu (11.000 habitants), le Premier ministre Saufatu Sopoanga est en discussion avec la Nouvelle-Zélande, pour qu'elle accepte d'accueillir les habitants de l'archipel en cas de nécessité. "Dans 50 ou 100 ans, les Tuvalu devraient être submergées. Que pouvons-nous faire?", demande-t-il. (AP) ajouté le 2004-05-22
-
Ottawa, Canada, 18/06 - Les températures printanières et estivales dans l`Arctique sont montées d`une façon incroyable au cours des trois dernières années et de vastes zones maritimes qui étaient naguère couvertes par la banquise en été sont désormais en eau libre, a expliqué lundi un explorateur britannique. Ben Saunders, qui a été contraint d`abandonner, pour cause de temps chaud, une tentative de traverser à ski en solo du nord de la Russie vers le Canada via le pôle Nord, dit avoir été stupéfié par l`ampleur de la fonte des glaces. "Il est clair pour moi que les choses changent considérablement et très rapidement", a-t-il dit à Reuters moins de deux jours après avoir été secourus sur une plaque de glace qui allait rétrécissant, non loin du pôle. "Je sais que cela est en train de se produire parce que c`était mon troisième séjour dans l`Arctique (au cours des trois dernières années)", a dit Saunders, qui a exploré la région de 2001 à 2003. Selon une étude internationale publiée l`an dernier, le réchauffement du climat mondial va entraîner la fonte de la majeure partie de la calotte glaciaire arctique en été, d`ici la fin du XXIème siècle. "Les températures étaient incroyablement chaudes(...). Certains jours, j`ai pu skier sans gants et sans bonnet, simplement mains nues, parce qu`il faisait trop chaud", explique-t-il. Les relevés effectués lors d`une expédition en 2001 montraient qu`à pareil moment de l`année, en mai, les températures moyennes de l`Arctique étaient de -15 à -20°C, alors que cette année, elles n`étaient que de -5 à -7°. "Chaque jour de mon expédition, j`ai vu de l`eau libre, et je ne m`y attendais pas", ajoute Saunders, qui a couvert 965 km, durant 71 jours, cette année, avant d`abandonner. "Je pense qu`une traversée à ski de la Russie vers le Canada, si les conditions demeurent les mêmes, est impossible", conclut-il. Saunders avait prévu de partir des îles les plus septentrionales de l`Arctique en mars mais au lieu de glace, il a découvert une bande d`eau libre de 70 km de long. Aussi a-t-il dû être acheminé par voie aérienne vers le début du pack.
-
Réchauffement de la planète, changements climatiques, effets sur la santé, le professeur Jean-Pierre Besancenot, chercheur CNRS à la faculté de médecine de Dijon, responsable du laboratoire climat et santé nous livre le fruit de ses recherches. Le moindre pic de chaleur enregistré ces jours derniers renvoie immédiatement à l'épisode de canicule du mois d'août. Vous êtes nombreux à vouloir prendre les devants, au cas où. Les effets de ces températures hors norme apparaissent pour beaucoup comme très inquiétants pour la santé. Que faire, quelles sont les conséquences prévisibles ? Car les scientifiques s'accordent désormais presque tous : d'autres périodes caniculaires se produiront dans les années à venir. Le professeur Jean-Pierre Besancenot, directeur de recherche CNRS à Dijon, responsable du laboratoire climat et santé à la faculté de médecine le confirme avec les conséquences qu'un tel phénomène induit sur la santé : « Des températures se maintenant à un niveau anormalement élevé peuvent faire des centaines, voire des milliers de victimes. On l'a observé, cette surmortalité touche principalement les personnes âgées, plutôt de sexe masculin en Amérique du nord et de sexe féminin en Europe. Les sujets à plus haut risque sont ceux qui vivent seuls, malades ou grabataires, ceux qui prennent à dose excessive des médicaments favorisant la surcharge calorique et (ou) les individus de faible niveau socio-économique, habitant des logements mal ventilés et non climatisés ». Le risque est aussi plus important pour les personnes vivant au dernier étage d'un immeuble. Toutefois précise encore le professeur, cette surmortalité n'est pas due uniquement à l'hyperthermie, à la déshydratation ou au coup de chaleur, « elle est aussi alimentée par les maladies cardio-vasculaires, cérébrovasculaires, respiratoires et mentales ». Pas de récupération nocturne Facteur par ailleurs très important : cette surmortalité dépend aussi en grande partie des températures minimales qui jouent souvent un rôle décisif, en permettant ou pas un repos nocturne réparateur. Ce qui n'était pas le cas l'an dernier lors de l'épisode de canicule qui a duré à peine quinze jours, alors qu'elle a semblé beaucoup plus longue du fait de sa pénibilité car, dans ce cas précis, la température nocturne ne descendait pratiquement pas en dessous de 24°. Le manque de fraîcheur empêchait de récupérer, le tout multiplié sur plusieurs jours a fragilisé les personnes les plus vulnérables. « La chaleur emmagasinée pendant la journée n'a pas pu s'évacuer, explique encore Jean-Pierre Besancenot, à cause de l'effet de serre qui a produit une sorte de chape sans possibilité de rafraîchissement ». Par ailleurs, la configuration des villes - Dijon est dans une cuvette - la construction dans nos climats continentaux accentuent encore le maintien de la chaleur, à la différence des pays méditerranéens ou situés dans des zones globalement plus chaudes : l'habitat avec des rues étroites, des petites ouvertures favorisent le maintien de la fraîcheur. La végétation joue aussi un rôle. Parcs et arbres sont autant d'éléments qui apportent de la fraîcheur. C'est ainsi qu'Athènes, qui accuse souvent une forte mortalité en été, remplace des zones d'habitat insalubre par des espaces verts. Urgence absolue La prise de conscience est donc déterminante « pour mesurer les risques et ainsi voir comment les gérer au mieux et mettre en place des actions de prévention ». Ainsi la climatisation qui apparaît comme la panacée et permet, il est vrai, de « souffler » un peu la nuit ou dans la journée après un séjour prolongé à la chaleur, est aussi un facteur de risque : la climatisation rejette de l'air chaud et accroît l'effet de serre, sans oublier le risque de légionnellose. En fait, dit encore le chercheur, « on peut s'adapter à un accroissement d'un à deux degrés mais il est vrai aussi que ce réchauffement de la planète risque de s'accompagner d'une hausse des phénomènes extrêmes, tempêtes, crues ». Les dernières mesures enregistrées l'attestent : depuis 1987, nous avons connu 8 années parmi les plus chaudes du XXe siècle et 1998, 2002 et 2003 ont été les trois plus chaudes de ces 35 dernières années. Conséquence prévisible : le rythme de la mortalité en France s'inverserait avec un plus grand nombre de décès en été - alors que, jusqu'ici, ces derniers étaient plus importants en hiver. Autre facteur à prendre en compte : la pollution qui, combinée à la chaleur provoque des problèmes de santé notamment en milieu urbain, avec des conséquences, là encore sur les personnes les plus vulnérables. Dans son étude « Environnement, risques et santé », le professeur Besancenot conclut : « De nombreux facteurs sont en jeu mais, en démêlant la complexité de cet écheveau, il devrait être possible de préciser, pour chaque endroit, les grandes orientations à imprimer aux politiques de protection civile et de santé publique pour que les vagues de chaleur soient de moins en moins synonymes de morts prématurées. Même si la quantité d'inconnues subsiste encore, la perspective d'un réchauffement planétaire confère à cette démarche une urgence absolue ». Anne-Marie KAISER Le temps et ses conséquences. Certaines personnes se disent très dépendantes du temps, d'autres pas. Qu'en est-il ? Une étude a montré que les risques d'infarctus sont plus importants par temps froid ; par exemple, lorsque la température moyenne descend en-dessous de - 4°, le risque est alors plus que doublé ; le froid a la propriété d'élever la tension. Cette même étude a mis en avant le rôle de la pollution atmosphérique jointe aux effets de la chaleur, surtout chez les fumeurs. Conséquences éventuelles d'une hausse des températures sous nos latitudes : le retour ou l'émergence de maladies comme le paludisme dont le dernier cas en France a été enregistré en 1943. Par ailleurs, le nombre de cancers de la peau est en augmentation en lien sans doute avec le rétrécissement de la couche d'ozone, les rayons UV pénétrant avec plus d'intensité. C'est ainsi que deux fois plus de cataractes ont été observées lors d'une étude chez des habitants du sud de la France. La même étude menée aux États-Unis a abouti aux mêmes conclusions. Prudence donc avec l'exposition au soleil, à éviter entre 11 et 18 heures (heure actualisée en fonction de l'heure solaire).
-
Fragile est l’équilibre écologique du Groenland. “Cet amas gigantesque de glace et les mers tourbillonnantes qui l’environnent sont devenus les pièces vitales d’un puzzle qui s’articule en fonction des changements climatiques”, note le New York Times, inquiet des conséquences du réchauffement de la planète. Avec d’une part l’Atlantique Nord et d’autre part la calotte glaciaire, “chaque pièce du puzzle forme un élément complexe qui, possède sa propre dynamique". Or “toute une série d’observations effectuées ces derniers mois ont démontré que les eaux et les glaces du Groenland sont sujettes à des changements en profondeur” qui pourraient “bouleverser les conditions climatiques relativement stables dans lesquelles les sociétés humaines modernes ont évolué". Si le New York Times ne croit pas à un scénario catastrophe imminent semblable à celui du film Le Jour d’après, il ne néglige pas les risques potentiels. Le problème est que l’extension de la zone de fonte de la calotte glaciaire vers l’intérieur du Groenland provoque en été la formation de bassins liquides. Mais l’infiltration de l’eau à travers des fissures facilite le glissement des glaces sur la roche de fond et accélère leur lente progression vers la mer. Si ce phénomène se généralise, il faut s’attendre à un afflux d’eau douce dans l’océan, “qui pourrait freiner les courants nord-atlantiques qui ont un effet modérateur sur le climat de l’hémisphère Nord". Pour l’heure, le Groenland est mesuré et observé sous toutes les coutures avec des moyens inédits, comme les satellites, afin de mieux comprendre ses énigmes et son devenir.
-
Températures plus élevées, atmosphère enrichie en dioxyde de carbone : globalement, le changement climatique à l’horizon 2100 devrait favoriser la croissance des arbres en France. Mais les changements dans la répartition des précipitations dans l’espace et dans le temps (plus de pluies en hiver et moins en été) devraient fortement influencer cette tendance générale. En utilisant un scénario régionalisé du changement climatique, les chercheurs de l’INRA en collaboration avec Météo-France ont montré que le déficit hydrique pourrait entraîner une baisse de la production forestière dans la moitié ouest de la France, du fait des fortes baisses de précipitations estivales sur la façade atlantique. Les chercheurs, dans le cadre du projet CARBOFOR, ont utilisé le modèle de simulation du changement climatique ARPEGE-Climat élaboré par Météo-France. A partir de l’hypothèse d’un doublement du taux de dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère entre 1975 et 2100 (scénario B2 du Groupe Intergouvernemental d'Experts sur le changement Climatique), ce modèle prédit un réchauffement moyen de + 2,3°C sur la France. Le nombre de jours de gel devrait baisser de moitié, la dernière gelée d’hiver intervenant trois semaines plus tôt. Les précipitations moyennes restent inchangées, mais leur répartition est fortement modifiée : au printemps, les précipitations diminuent en moyenne de 30 mm, en été de 26 mm, avec une baisse plus marquée dans la moitié ouest, notamment le sud-ouest. Les chercheurs ont étudié l’impact de ce changement sur le cycle phénologique des arbres, c’est à dire sur la succession dans le temps des différents stades du développement des arbres. Ils ont travaillé à partir des données phénologiques disponibles pour sept espèces forestières majeures. Pour les feuillus étudiés (le hêtre, le frêne, le chêne sessile et le chêne pédonculé), le débourrement, c’est à dire la reprise de croissance des bourgeons, l'élongation des rameaux et la sortie des feuilles qui débutent la saison de végétation après l’hiver, est avancé de 6 à 10 jours. Pour le pin maritime, le débourrement serait avancé en moyenne de 20 jours. En ce qui concerne le pin sylvestre et l’épicéa, espèces ayant des besoins en froid conséquents préalables à la reprise de la végétation, le modèle suggère un débourrement retardé en plaine mais une avancée sur les reliefs. Pour toutes les espèces, le modèle prédit une baisse du risque de gels tardifs, après le débourrement, ce dernier se produisant toujours à des températures plus élevées. Les chercheurs ont alors estimé, pour le hêtre et le pin maritime, l’augmentation de la croissance potentielle des arbres, en tenant compte de la reprise plus précoce de la végétation et des nouvelles données climatiques et atmosphériques. Selon ce scénario, la production nette en France devrait augmenter entre 2 % et 15 % suivant les localisations considérées. Le principal moteur de cette hausse est l’effet de l’augmentation du CO2 atmosphérique. Mais cette tendance générale peut être inversée en fonction des conditions hydriques et thermiques locales et de la fertilité des sols. Ainsi, le bilan est fortement positif sur l’est de la France et les reliefs, alors que le modèle suggère des baisses de production sur la moitié ouest, qui peuvent atteindre localement - 30%. Ceci s’explique par les fortes baisses des précipitations estivales simulées par ce scénario sur la façade atlantique. Pour le pin maritime, avec une hypothèse de fertilité basse, la production nette pourrait baisser de 15% sur le nord de la forêt landaise alors que la production augmenterait légèrement au sud de ce massif. Le principal enjeu de la gestion sylvicole dans la seconde moitié du XXIème siècle devrait ainsi être la gestion des contraintes hydriques et nutritionnelles et le choix des espèces et variétés utilisées pour la régénération. Ce nouveau contexte nécessitera le développement de nouvelles pratiques culturales pour atténuer les effets des déficits en eau (améliorer la profondeur d’enracinement, contrôler l'indice foliaire des peuplements et la végétation de sous-bois, etc.), la sélection d’espèces et de variétés mieux adaptées à la sécheresse et une meilleure gestion des nappes phréatiques, tant au niveau local que régional.
-
Le décalage entre les températures mesurées au sol et les températures mesurées par satellite –moins élevées- alimente le débat sur la nature du réchauffement climatique. Dans une étude publiée aujourd’hui dans la revue Nature, des chercheurs pensent pouvoir réconcilier tout le monde en décryptant la cause de cette différence. C’est l’interaction entre la troposphère, la première couche de l’atmosphère, et la stratosphère, qui est au-dessus, qui explique que les températures relevées par les satellites sont plus basses, expliquent Qiang Fu, de l’Université de Washington, et ses collègues. Ils ont analysé des données enregistrées entre 1979 et 2001 par les satellites polaires de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), données qui permettent de connaître les températures dans les différentes couches de l’atmosphère. La stratosphère refroidit les températures mesurées par les satellites, constatent les chercheurs. Une fois corrigées, ces températures rejoignent celles qui sont mesurées au sol et dans la troposphère et corroborent les prédictions des modèles de réchauffement climatique, concluent les auteurs. Pour mieux connaître l’atmosphère et les mécanismes impliqués dans le réchauffement climatique, la NASA, le CNES et l’Agence spatiale canadienne développe un programme baptisé «The ATrain» -un clin d’œil au jazzman Duke Ellington. Il s’agit de cinq satellites placés très près les uns des autres qui pourront étudier sous des aspects différents la même portion de l’atmosphère à 15 minutes d’intervalle. Le dispositif sera opérationnel en 2005. (06/05/04)
-
Les conséquences d’un réchauffement planétaire
-
Le réchauffement de la planète
-
Le réchauffement climatique : réponse à quelques questions élémentaires
-
http://membres.lycos.fr/controvenso/
-
Le réchauffement climatique (le changement climatique) : réponse à quelques questions élémentaires
-
En 1995, les chercheurs mandatés par les Nations Unies ne croyaient pas que le réchauffement de la planète dépasserait 3 degrés d'ici 2100. Leur rapport révisé parle maintenant de 6 degrés – un désastre. Au cours du prochain siècle, le réchauffement de la planète sera deux fois pire qu'on le pensait jusqu'ici. C'est du moins ce que croit le Panel intergouvernemental sur les changements climatiques, un groupe de centaines de chercheurs mandaté par les Nations Unies. Une version préliminaire de son rapport, qui doit être adopté en mai 2001, circule depuis la mi-octobre dans les divers gouvernements de la planète. La version précédente, en 1995, prévoyait une hausse de la température de 3 degrés d'ici 2100, ce qui était préoccupant. Les chiffres révisés estiment que la hausse pourrait atteindre 6 degrés – un véritable désastre. Les émissions de gaz carbonique liées à l'activité humaine atteignent actuellement 6,8 milliards de tonnes par année. En 2100, elles pourraient atteindre 29 milliards de tonnes, si elles continuent à progresser au rythme actuel. À ce niveau, il est probable que des forêts entières mourraient sur pied à cause des changements climatiques. Cette mort accélérée libérerait le gaz carbonique emprisonné par les plantes, portant les émissions annuelles au niveau fantastique de 35 à 40 milliards de tonnes. Il existe encore quelques incertitudes sur l'effet de tout ce gaz carbonique sur le climat. Après tout, une petite partie du réchauffement semble reliée à des causes parfaitement naturelles. C'est pourquoi le niveau de réchauffement d'ici 2100 n'est guère précis : de 1,5 à 6 degrés. Mais il est certain que toute augmentation significative de la température aurait des effets dramatiques : climat déréglé, récoltes perdues, forêts détruites, fonte d'une partie des glaces de l'Antarctique et inondation de régions côtières. En 1997, la communauté internationale s'est entendue pour réduire de 5,2% (par rapport au niveau de 1990) ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2008 à 2012. Aucune nation industrialisé n'a encore ratifié cet accord et tout indique que ses objectifs ne seront pas atteints. Ils sont pourtant modestes. Le panel intergouvernemental estime qu'il faudrait réduire les émissions de 60% d'ici 2050 pour maintenir le réchauffement de la planète à un niveau acceptable. Nul doute que ce rapport viendra hanter les prochains pourparlers sur l'application de cet accord, qui doivent avoir lieu aux Pays-Bas dans un mois.
-
11 juin 2004 Le quotidien parisien “Libération” a consacré un important dossier au réchauffement climatique, dans son édition d’hier, sous le titre générique : « Le pire est pour demain ». Ce que le journal affirme, preuve scientifique à l’appui, décrit ce réchauffement comme une « arme de destruction massive ». Synthèse. Le premier article de la série publiée par “Libération” s’intitule "Avis de chaleur au fin fond de l’Antarctique". Le journaliste, Sylvestre Huet, retrace les travaux d’une équipe européenne qui a analysé plus de 3 km de glace du pôle Sud. "Des résultats inquiétants qui confirment la rapidité du réchauffement climatique". Ce “bout de glace”, congelé depuis des centaines de milliers d’années a été examiné sous toutes les coutures par une équipe animée par le climatologue Jean Jouzel. Conclusion des travaux : "les émissions de gaz à effet de serre se sont de nouveau envolées en 2003, s’éloignant toujours plus des objectifs de la Convention climat de l’ONU. Et promettant de bouleverser le climat". Ce "signal d’alarme" succède à un autre, tiré en 1987 par le glaciologue grenoblois Claude Lorius. "Pour la première fois les scientifiques disposaient de l’histoire simultanée du climat et de l’effet de serre. Ils pouvaient mesurer que celui-ci et les températures moyennes de la planète évoluent bien de concert. Plus l’effet de serre s’intensifie, plus le thermomètre grimpe... et inversement". Le journaliste explique : "Nous étions partis pour une longue période chaude et calme, d’encore une dizaine de milliers d’années. À condition de respecter l’une des données du passé : un effet de serre uniforme, comme ce fut le cas au long des 28.000 années de cette ère chaude, la plus proche de la nôtre en termes d’énergie solaire reçue par la Terre". Ce qui n’a pas été le cas, l’être humain étant passé par là, lui qui "a pris rang parmi les forces géologiques qui sculptent le nouveau visage de la Terre". Pour le journaliste, "la canicule de 2003 deviendrait la norme pour le climat français après 2050. Tandis que le climat planétaire, bouleversé à grande vitesse, soumettrait à rude épreuve économies, sociétés et relations internationales". Et d’expliquer que les chercheurs européens ont une "pole position" au sein du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat mis en place par l’ONU). Il s’interroge : "cette pole position de l’Europe poussera-t-elle l’Union européenne à prendre la tête d’un mouvement mondial de restriction des émissions de gaz à effet de serre, afin de limiter le réchauffement en cours ?". Plus 3 à 8 degrés... Le deuxième article du dossier de “Libération” est consacré à un entretien avec Jean Jouzel, celui qui a dirigé l’opération scientifique d’analyse de la glace antarctique. Le constat du climatologue est dramatique : "Nous avons explosé le compteur des gaz à effet de serre" explique-t-il au journaliste. "La teneur en gaz carbonique est déjà passée de 280 à 370 ppm (parties par million) depuis la révolution industrielle. Et le méthane a grimpé de 650 à 1.750 ppb. Plus grave : si nous persistons à augmenter nos émissions - par l’usage massif du charbon, du gaz et du pétrole comme par la déforestation - nous pourrions atteindre près 1.000 ppm de CO2 en 2100. À la stabilité promise par la nature, nous substituons, ce faisant, le risque d’une excursion brutale, instantanée à l’échelle géologique, dans un climat inconnu sur Terre depuis des millions d’années". Le scientifique est clair : "S’y nous n’y prenons pas garde, nous provoquerons un réchauffement d’environ 3°C à l’horizon 2100 (...). Cette moyenne masque des variations bien plus brutales. De 4 à 5°C sur l’Europe, mais de 8°C à 10°C sur les hautes latitudes nord, les océans se réchauffant moins vite. L’Europe du Nord serait affectée de pluies surabondantes l’hiver, tandis que le pourtour méditerranéen subirait des sécheresses accrues l’été. Inondations pour les villes du Nord, pénurie d’eau, source de conflits géopolitiques, au sud. Une hausse de 50 cm des océans concernerait par ailleurs directement 200 millions de personnes." "Une hausse pratiquement irréversible et qui se poursuivra plusieurs siècles au même rythme. La fonte accélérée des glaciers continentaux modifiera le régime des fleuves. La biodiversité souffrira en raison de la rapidité des changements. Nous pouvons donc, en un demi siècle, enclencher un bouleversement climatique majeur, irréversible, dont les conséquences pèseront sur nos petits-enfants", déclare le climatologue. Le journaliste lui demande où se situent les principales incertitudes des scientifiques : "L’amplitude et le rythme du réchauffement demeurent dans une fourchette de deux ou trois degrés pour un même scénario d’émission de gaz à effet de serre. Et il reste très délicat d’explorer les dimensions régionales du changement. La variabilité climatique, donc la fréquence des événements extrêmes, semble devoir augmenter, mais nous avons du mal à la quantifier. De même pour la fréquence des cyclones. Les précipitations, comme les régimes de mousson, résistent à la simulation, alors qu’il s’agit de paramètres décisifs pour l’agriculture et la sécurité alimentaire. Les modes climatiques - El Niño, l’oscillation Nord-Atlantique - sont encore mal compris. Or, ils affectent l’économie, l’agriculture, les pêches (...). Mais il ne faut pas attendre pour agir, en raison de l’inertie du système climatique. Dans cinquante ans, il sera trop tard". Il y a donc urgence, des efforts doivent être faits à "commencer dès maintenant dans les pays riches - principaux pollueurs historiques - si l’on veut y rallier dans l’avenir des pays en voie de développement qui ont un besoin crucial d’énergie pour sortir des milliards de gens de la pauvreté". "Une arme de destruction massive" Un article expliquant les conditions dans lesquelles l’étude a eu lieu complète ce dossier de “Libération”. Et il se termine par un éditorial signé Patrick Sabatier, intitulé “Titanic”, dans lequel le chroniqueur explique que "le changement climatique est bien une arme de destruction massive. Ses effets sont lents, mais se font déjà sentir sur la planète. Ils peuvent être aussi dévastateurs pour les générations futures que le sida pour la nôtre. Le rythme du réchauffement, et de l’accumulation des gaz à effet de serre qui y contribuent, est plus rapide qu’on ne l’imaginait". "Notre capacité à en atténuer les effets (il est déjà trop tard pour l’éviter) diminue" rajoute Patrick Sabatier. "La question n’est plus de savoir comment l’activité humaine change le climat de la planète, mais pourquoi le déni de réalité continue de tenir lieu de politique. L’étude dont nous rendons compte conforte le consensus scientifique sur la réalité et les mécanismes de l’impact d’Homo sapiens sur le climat en raison de son utilisation massive d’énergies fossiles. Incitera-t-elle l’humanité à donner un coup de barre pour éviter que son Titanic planétaire ne frappe l’iceberg apparu sur son radar, mais vers lequel elle continue de foncer à toute vapeur ?". Quelques chiffres Entre 1860 et 2000, la température moyenne de la Terre a augmenté de 0,8°C. L’une des causes en est un effet de serre accru par les émissions humaines de gaz carbonique, méthane, protoxyde d’azote par l’industrie, la production énergétique, les transports, la construction, l’habitat, l’agriculture... Le pire des scénarios : Les chiffres de l’énergie mondiale en 2003 montrent une hausse de 2,2 %, une vive croissance du charbon, du pétrole et du gaz. D’où un emballement des émissions de gaz à effet de serre, en ligne avec la pire des prévisions étudiée par les climatologues : entre 3,7°C et 8,7°C de plus en un siècle.
-
Avec des températures pouvant dépasser parfois de 10° celles de la campagne, le climat urbain présente des spécificités mal connues des météorologues. En lançant la campagne Capitoul, Météo-France se donne un an pour mieux comprendre l'influence des villes sur le climat. « Le phénomène est connu depuis la fin du 19e siècle. Il y a déjà eu des campagnes de mesure, mais elles ont toujours été ponctuelles », raconte le chef du projet Capitoul, Valéry Masson. Cette fois, la campagne, débutée en mars, durera un an. Une trentaine de chercheurs et de techniciens y participent. « Notre objectif est d'expliquer quels peuvent être les mouvements des masses d'air sur une zone de 20 km de rayon sur 1 km de haut et comment la ville agit sur l'atmosphère », explique M. Masson. Siège de Météo-France, Toulouse a été en outre retenue pour ses caractéristiques géographiques : située à distance de la mer et de la montagne, elle n'en subit pas les effets. Trois périodes d'observation intensive (mars, juin-juillet et novembre-février) permettront d'affiner le dispositif à l'aide de mesures aériennes. Une telle étude devrait permettre d'observer plus précisément le phénomène d'« îlot de chaleur urbain » : la nuit, la température en ville est plus élevée que dans les zones rurales avoisinantes. L'écart observé, renforcé en situation anticyclonique, peut ainsi atteindre à Toulouse 8 à 10°. Dans la journée, l'énergie fournie par le soleil est utilisée par les plantes, alors qu'en ville, les matériaux urbains (routes, béton, tuiles...) stockent la chaleur, avant de la restituer progressivement la nuit. Les études menées jusqu'ici sur l'îlot de chaleur urbain ont souvent été réalisées en été. En étalant la campagne sur un an, Météo-France pourra également juger de l'influence sur le climat hivernal du chauffage des bâtiments, qui contribue au réchauffement de l'atmosphère urbaine. Autre question posée : « La brise urbaine existe-t-elle ? ». Lors de conditions anticycloniques, la différence de température ville-campagne semble en effet provoquer une brise très légère, de l'ordre de 5 km/h. Capitoul devrait également permettre d'étudier le comportement des aérosols, ces microparticules émises dans l'atmosphère par les pollutions urbaines, et d'observer leur impact sur l'ensoleillement et l'effet de serre.