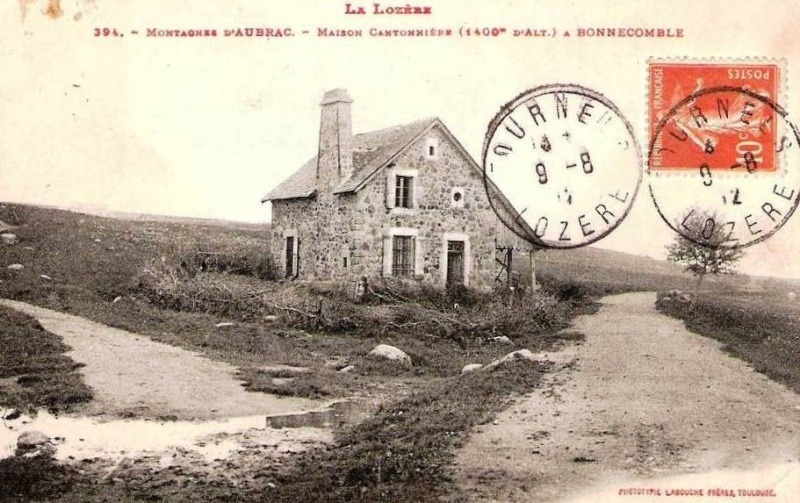-
Compteur de contenus
333 -
Inscription
-
Dernière visite
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Nyko
-
NATIONS UNIES (AP) - Le phénomène est lent mais il progresse partout, comme une maladie de peau : la désertification augmente chaque année et, aujourd'hui, c'est un tiers de la planète qui est menacée, au risque de provoquer des déplacements massifs de populations, selon les Nations Unies. Jeudi sera la journée mondiale de la lutte contre la désertification. Ce sera aussi le dixième anniversaire de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, un traité signé par 191 Etats, le seul de cette ampleur qui porte sur le problème de la dégradation des terres dans les zones rurales arides. La surexploitation des terres agricoles et des ressources en eau,, les cultures sur brûlis, la déforestation ou de mauvaises pratiques d'irrigation contribuent à la désertification, mais aussi l'accroissement de la population mondiale. Et la tendance est sans doute accentuée par le changement climatique. Le phénomène n'est certes pas nouveau. Etudiant les pollens et semences fossiles, des outils préhistoriques, voire simplement la littérature ancienne, les scientifiques ont montré que la plus grande partie du Moyen-Orient, des régions méditerranéennes et de l'Afrique du Nord, y compris le Sahara, ont autrefois été verts. Mais, malgré l'adoption de la convention, la désertification a plutôt tendance à s'accélérer. Depuis le milieu des années 90, on estime qu'en moyenne 3.436 sont chaque année transformés en désert, contre 2.100 km dans les années 80 et 1.560 dans les années 70. A ce rythme les spécialistes ont calculé que, d'ici à 2025, les deux tiers des terres arables d'Afrique auront disparu, comme un quart de celles d'Asie et un cinquième de celles d'Amérique du Sud. Les régions les plus exposées sont celles qui jouxtent les déserts actuels, comme le Sahara ou désert de Gobi. Mais le phénomène n'épargne par l'Europe, et 31 % de l'Espagne risque de se transformer progressivement en désert. Les conséquences sur le niveau de vie des populations risquent d'être dramatiques. Selon les Nations Unies, 135 millions de personnes - soit l'équivalant des populations de la France et de l'Allemagne réunies - sont menacées de devoir de déplacer pour survivre. Le thème retenu par les Nations Unies de la Journée de jeudi sera d'ailleurs "migration et pauvreté" afin d'insister sur les dimensions sociales de la désertification. Pour Kofi Annan, Secrétaire général des Nations Unies, celle-ci "contribue à l'insécurité alimentaire, à la faim et à la pauvreté et peut susciter des tensions sociales, économiques et politiques qui, à leur tour, entraînent des conflits et une aggravation de la pauvreté et de la dégradation des sols".
-
Il y a 420.000 ans, la Terre a connu une période chaude comparable à celle que nous connaissons aujourd'hui. C'est ce qu'ont découvert des scientifiques au terme d'une analyse de glaces antarctiques sur les 740.000 dernières années. Oeuvre de chercheurs et d'ingénieurs de dix pays européens réunis dans le cadre du projet de carottage dans les glaces d'Antarctique EPICA (European Project for Ice Coring in Antarctica), lancé en 1995, cet exploit scientifique et technologique a été réalisé à partir d'échantillons de glace collectés en huit ans par carottage à la base franco-italienne Concordia, située au Dôme C, à plus d'un millier de kilomètres à l'intérieur du continent. Huit cycles en 740 000 années Trois résultats fondamentaux ont été obtenus par l'analyse de la teneur des glaces "fossiles" en deutérium (isotope naturel de l'hydrogène qui, aux températures ordinaires, est un gaz) de la glace, expliquent les auteurs de cette vaste étude, signée d'une cinquantaine de noms, dont ceux de nombreux scientifiques français du CNRS et du Commissariat à l'énergie atomique. Le premier, c'est que les climatologues savent désormais que depuis 740.000 ans, la Terre a subi huit cycles, marqués par des alternances de périodes glaciaires et de périodes plus chaudes, dites interglaciaires, avec, deuxième grand enseignement, un changement brutal du rythme des cycles il y a 420.000 ans. "A cette époque, la planète a connu une période chaude particulièrement longue, de 28.000 ans environ et qui, surtout, peut être considérée comme analogue à celle que nous connaissons actuellement", explique l'un des auteurs. Mais, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, à cette période lointaine, où la Terre était habitée par des "Homo erectus" formant une population très clairsemée à travers le vieux monde, l'influence de l'homme sur le climat était nulle. "L'analogie entre les deux climats s'explique notamment par les conditions astronomiques, parce que l'orbite, l'axe de la Terre qui influencent l'ensoleillement sont identiques", a précisé Valérie Masson-Delmotte. "Cela suggère que la prochaine entrée en glaciation n'aura pas lieu avant plusieurs millénaires." Influence de l'homme sur le climat Troisième résultat, lié, lui, à l'actualité "chaude", l'analyse des bulles d'air emprisonnées dans les glaces antarctiques confirme que "les teneurs actuelles en gaz à effet de serre (dioxyde de carbone et méthane) atteignent le plus haut niveau jamais vu", a relevé Jérôme Chapellaz (Laboratoire de glaciologie et de l'environnement de Saint-Martin d'Hères). L'influence des activités humaines sur le climat ne fait donc plus aucun doute, mais ses conséquences constituent toujours une grande inconnue.
-
Emmanuel Le Roy Ladurie, historien du climat, explique dans « Histoire humaine et comparée du climat » (Fayard, sortie le 10 juin) comment, en raison des incidents climatiques, la France a vu, entre autres, sa population diminuer de moitié de 1328 à 1440 Durant deux millénaires, la date des vendanges fut une grande préoccupation des sociétés rurales en Occident. Précoce ou tardive, aucun des chroniqueurs, au Moyen Age, ne manquait de la signaler. A la fin des années 50, Emmanuel Le Roy Ladurie, « visitant » les paysans de Languedoc sous l'Ancien Régime pour les besoins de sa thèse, put y mesurer l'importance de la conjoncture vigneronne. Le jeune historien - il est né en 1929 - en comprit aussi tout l'apport à ce qui devint dès lors une grande affaire de sa vie intellectuelle : l'histoire du climat. Au mûrissement instable de la grappe et de la gerbe s'ajouta le regard qu'il porta sur l'évolution des glaciers, inscription vivante des variations séculaires du temps qu'il a fait. Puis, lecture faite des travaux innombrables et dispersés des climatologues, géologues, glaciologues, palynologistes et autres dendrochronologistes, fut élaborée dans l'allégresse une synthèse originale et puissante, l'« Histoire du climat depuis l'an mil », parue en 1967. Le « petit optimum médiéval » et le « petit âge glaciaire » eurent désormais les honneurs populaires du sigle, POM et PAG. Grâce à Le Roy Ladurie, le climat devenait à l'Histoire ce qu'il avait été à la philosophie politique avec Montesquieu. Il y a quarante ans, l'histoire climatique avait été traitée en soi, écartant délibérément tout anthropocentrisme. Restait à franchir une « deuxième étape, écrivait alors Le Roy Ladurie, au cours de laquelle le climat ne serait plus envisagé pour lui-même, mais comme ce qu'il est pour nous, comme écologie de l'homme », tant il est vrai que le gel et la canicule continuent, comme le prouvent les deux extraits qui suivent, même dans les sociétés les plus avancées, de faire la pluie et le beau temps. Après bien des excursions très remarquées dans d'autres territoires historiques, le professeur honoraire au Collège de France, membre de l'Institut et docteur honoris causa de treize universités étrangères, présente aujourd'hui, au sommet de sa maturité, avec cette « Histoire humaine et comparée du climat », la deuxième partie d'un programme conçu au temps de sa jeunesse 1420/2003 - MÊME COMBAT «Parmi les années de vendanges précoces assez bien caractérisées de la période 1415-1435, le millésime 1420 se détache, au Nord comme au Sud (mais, on va le voir, avec un fort accent méridional, notamment toulousain) ; pour nous en tenir à la Bourgogne, les vendanges 1420 à Dijon sur la série Lavalle six fois séculaire sont parmi les plus précoces connues (25 août). On se croirait en 2003 ! [...] « Metz, 1420 : temps beau et chaud pendant le printemps, muguet fleuri le 10 avril. Maturation précoce des fruits : fraises mûres le 10/4 ; cerises le 9/5 ; fèves et pois le 10/5 ; seigle nouveau le 15/5 ; verjus nouveau le 19/5 ; raisins presque mûrs le 1/7 ; vin nouveau le 31/7 ; fruits, les uns et les autres (mais pas forcément les céréales) abondants et bon marché. » D'une façon générale, les vendanges de 1420 sont en avance d'un mois sur leurs dates usuelles. L'été est à l'indice 9 maximal, « extremely warm », sur l'échelle de Van Engelen et il vient après un hiver doux. On ne compte pendant l'époque du petit âge glaciaire que neuf étés à l'indice 9 (ce sont 1326, 1420, 1422, 1473, 1540, 1556, 1781, 1783 et 1846) ; et puis trois étés à l'indice 9 lors de la phase du réchauffement contemporain, jusqu'en 2000 : ce sont 1859, 1868, et 1994. [...] Ces jolies chaleurs ont donné (comme il arrive à mainte reprise en telle conjoncture) de bonnes récoltes de céréales, en secteur Est : superbes blés bien mûrs, bien lourds, bien récoltés sous un ciel bleu très breughélien. Il en va ainsi à Stuttgart et en Rhénanie-Westphalie... Mais ailleurs, « chez nous », plus à l'occident, ce n'était plus tiédeur féconde lors de l'énorme ensoleillement de 1420. C'était un brûlage. Echaudés, étrillés, réduits, les épis le sont sur un axe anglo-franco-occitan, en partie « Plantagenêt », qui va de Winchester à Paris et de l'Ile-de-France à l'Aquitaine. Le fait est qu'en zone anglaise la moisson de 1420 a été « frumento*-déficitaire » : les rendements des céréales ont baissé de 23,1 % au sud de la grande île (évêché de Winchester), l'été fut effectivement très sec (Siccitas estivalis) et l'on a dû acheter du foin pour les boeufs de labour, la prairie winchestérienne ayant manqué à tous ses devoirs en raison du déficit pluviométrique. Quant à l'« Hexagone » ? Quid d'un 1420 franco-français, j'allais dire oc-oïl ? En zone d'oïl, l'« Oïlanie », en particulier l'Ile-de-France et les zones ultranordistes aujourd'hui françaises, une assez forte hausse des prix du froment s'impose pour 1420, étalée en fait sur toute l'année post-récolte 1420-1421 : à Douai (comme à Anvers) on passe de 0,50 livre parisis la rasière fromentale en octobre 1419 à 0,77 en octobre 1420 et 1,04 en octobre 1421. Doublement. Même le prix des chapons nourris de grain s'en ressent (un peu) [...] Plus au sud, les guerres autour de la capitale n'arrangent rien en raison de violentes péripéties, postérieures au traité de Troyes (mai 1420). Dès l'Avent 1420, le bourgeois de Paris se fait l'écho de la famine en cours : « Item, écrit-il [en décembre 1420], enchérit tant le blé et la farine que le setier de blé froment valait à la mesure des halles de Paris 30 francs de la monnaie qui lors courait ; et la farine bonne valait 32 francs, et autre grain haut prix, selon qu'il était ; et n'y avait point de pain à moins de 24 deniers parisis pour pièce, qui était à tout le bran [son], et le plus pesant ne pesait que 20 onces ou environ. [...] Et sur les fumiers parmi Paris (en) 1420, pussiez trouver ci dix, ci vingt ou trente enfants fils et filles, qui là mouraient de faim et de froid, et n'était si dur coeur qui par nuit les ouît crier ; « Hélas ! je meurs de faim ! » qui grande pitié n'en eût ; mais les pauvres ménagers ne leur pouvaient aider, car on n'avait ni pain, ni blé, ni bûche, ni charbon. » Le prix de l'avoine a vingtuplé Comme l'écrit sobrement l'un de nos chronologistes, « 1421, printemps, la famine sévit ». Effectivement les prix des céréales ont beaucoup monté sur le marché des bords de Seine, au cours de l'an post-récolte 1420-1421. Le seigle, d'après Fourquin, se situait aux environs de 6 à 9 sous parisis le setier lors des années antérieures à 1415, puis la hausse vertigineuse intervient ; 3 à 4 livres parisis en mai 1421, après une très mauvaise récolte 1420 surgie out of the blue, à partir d'un ciel trop constamment bleu, dix mois plus tôt. Quant au prix de l'avoine circumparisienne, il a vingtuplé entre 1415 et avril-mai 1421 ! L'inflation-dévaluation des monnaies a contribué bien sûr, pour une forte part, à ce processus presque incroyable. Mais elle ne jouait pas en solo, puisque compliquée de disette, elle-même fille des amours monstrueuses qu'ont nouées le mauvais climat et la guerre dévastatrice [...]. Malgré tout, elles ne sont pas seules en cause puisque, contre-épreuve démonstrative, l'assez bonne récolte de l'été 1421 fera baisser le prix du seigle des campagnes parisiennes à 3,1 livres parisis en septembre 1421, et puis 2,5 livres en octobre, pour le fixer à la fin aux environs de 2,1 livres en 1422-1423 [...]. Façon de rappeler aussi, en dépit de toutes les jérémiades rétrospectives des partisans du laisser-faire et autres libertariens ou économistes libéraux, qu'en 1420 comme pratiquement en toute période de l'ancien ou très ancien régime économique on était déjà, quant au blé, dans un système [...] de l'offre et de la demande qui dictait les prix dans les halles des marchés urbains [...]. Dans le Midi, lequel était plus vulnérable au chaud-sec que le Bassin parisien, l'année 1420 fut désolante : « Albi, mars-avril et mai très secs ; aucune pluie en mai, sauf à deux reprises. » Précocité typique d'une année chaude : cerises albigeoises mûres le 16 avril ; récolte de seigle précoce à partir du 25 mai et mauvaise moisson... très vraisemblablement par échaudage et sécheresse, compte tenu du contexte météorologique qui vient d'être indiqué. Mauvaise récolte à Pamiers (Ariège) et mauvaise collecte du blé aussi autour de Sienne, précocité des vendanges en Ligurie. Tout se tient, logiquement et factuellement. D'où la puissante hausse des prix du blé à Toulouse lors de l'année-récolte 1420-1421. On passe de 13 sous le carton en 1419 à 26 sous en 1420 et 56 sous en 1421. Hausse diagnostiquée avec la plus grande précision par Philippe Wolff, mais qu'il a tort d'attribuer uniquement à l'inflation monétaire alors que la météorologie tant aquitaine qu'européenne y est certainement pour beaucoup. Quoi qu'il en soit, l'année-récolte 1420-1421 fut, parmi quelques autres, une étape non négligeable, au long de la spirale descendante qui mène la démographie française des 20 millions d'âmes de 1328 aux 10 millions d'habitants de 1440. Une dizaine de millions d'âmes s'étant, graduellement ou par à-coups successifs, évaporée dans l'intervalle. L'épidémie bien sûr a donné aux famines le coup de pouce qui s'imposait, étant post-corrélative de celles-ci, ou déclenchée sur le mode autonome. Ce sont les fameuses gâchettes qui s'enclenchent l'une après l'autre, qu'évoquera Jaurès, beaucoup plus tard, dans un tout autre contexte. De fait, le coup de chaleur et de disette de l'été 1420 fut certainement suivi d'une épidémie opportuniste, consécutive à cet épisode climatiquement et frumentairement difficile. S'agit-il d'une peste ou tout simplement d'une dysenterie, venant après plusieurs mois secs et surtout brûlants, par infection des rivières à demi asséchées ? [...]. En tout cas sur le fait lui-même de la mortalité de la crise, passage de la faim à la morbidité, les documents recueillis par Philippe Wolff à Toulouse sont clairs : « Grâce à un registre du Collège de Périgord, voici des renseignements précis sur l'épidémie de 1420 : le vendredi 13 septembre, le prieur diminue l'ordinaire du Collège, plusieurs étudiants ayant quitté la ville par peur de la mortalité ; en décembre, le prieur doit se rendre à Rodez, afin d'y trouver pour les travaux des vignes la main-d'oeuvre qui, à Toulouse, s'est raréfiée en raison de l'épidémie. C'est à celle-ci sans doute qu'on fait allusion dans un acte de 1424, où il est reproché à sire Jean de Gauran, professeur de droit, d'avoir consommé les blés, foins et volailles d'une métairie située dans le faubourg de Toulouse, métairie appartenant à l'un de ses amis, chez lequel il s'était réfugié avec sa famille, ses serviteurs et ses chevaux lors de la mortalité : au bout d'un mois, c'est vrai, le réfugié y était mort, sans avoir dédommagé son logeur. » Le complexe famine-épidémies de 1420 a certainement frappé d'un bout à l'autre du territoire (actuel) de la France, puisqu'on retrouve, telle quelle, la très forte mortalité de ce même an, à Cambrai et dans le Cambrésis, étudié de fort près pour cette année et pour quelques autres par Hugues Neveux. 1636/2003 - LA « MÉGAMORT » «L'année 1636 réserve au météo-chroniqueur une désagréable impression : en dépit de situations frumentaires radieuses, elle se traduit par une violente éruption du nombre de morts [...]. Approche-t-on le demi-million supplémentaires ? La crise de subsistance, inexistante en cet an-là, n'y est pour rien. Jamais, à un cheveu ou epsilon près, les prix du blé n'ont été aussi bas qu'en 1636, par rapport à toute la période qui va de 1631 à 1644. Il faut donc trouver autre chose, autre facteur, quant à cette prédominance de Thanatos en 1636. La peste ? Bien sûr. En 1636, on ne compte pas moins de 51 villes « françaises » affectées par cette maladie. Mais est-ce le motif suffisant ? En 1628, le chiffre annuel homologué montait à 80 villes pesteuses ; en 1630, un peu davantage ; en 1629, idem ; et pourtant les nombres de décès n'atteignaient point aux records de 1636. Suggérons donc à ce propos une cause additionnelle des trépas multiples : à savoir la dysenterie, en plusieurs reprises incriminée déjà par les démographes dans les cas de « mégamort » [...] Citons à ce propos [...] un texte essentiel : « Cette année 1636 a été mémorable [dans la région de Lille] pour la grande mortalité et contagion qui a été très forte par tous les pays, villes et villages, ayant emporté une bonne partie des créatures [...] par fèbvres chaudesz, dissenteries [souligné par nous LRL] et autrement, le tout causé par la guerre, vray pépinière de tous maux. » Ce texte, exactement contemporain de l'événement, est dû au « Nordiste » Jean de La Barre. Notons qu'il ne mentionne pas la peste, bien qu'elle ait sévi à Lille également cette année-là (d'après Biraben). Le sieur de La Barre signale de façon prédominante, comme cause de mort massive, « fièvres chaudes et dysenteries » présentées comme liées à la guerre. Cette « liaison » paraît vraisemblable, en effet. Mais cette dysenterie [...] est bel et bien corrélative, par ailleurs, de l'été puissamment calorifique de 1636, ce même été qui, point trop sec par ailleurs en juin-juillet-août, a produit de belles moissons génératrices de bas prix du grain... et de vins excellents. Eaux de boisson polluées Que la dysenterie soit liée, entre autres, aux étés chauds qui font baisser le niveau d'eau des rivières, les rendant d'autant plus polluées, sales, et qui par ailleurs font pulluler dans les eaux de boisson, d'où qu'elles viennent, les shigelles, colibacilles, salmonelles et autres micro-organismes dysentériques, c'est bien certain. [...] François Lebrun s'est « beaucoup intéressé » aux épidémies de dysenterie, outre 1636, celle de 1639, 1706 et 1707, enfin 1779. Le même auteur souligne à plusieurs reprises le lien entre ces épidémies bien particulières et tel épisode de forte chaleur estivale relayé ensuite par l'automatisme de la contagion interhumaine, dû au contact excrémentiel des mains sales, aux consommations d'eaux impures, etc. Or il est remarquable que toutes les années dysentériques [...], allant facilement aux 400 000 décès supplémentaires, [...] ont des vendanges soit précoces, soit ultraprécoces, toutes situées en septembre, indicatives d'un été chaud ou ayant comporté à tout le moins un fort épisode chaud, susceptible de hâter la collecte du raisin... et de déclencher la terrible maladie diarrhéique en question, notamment les toxicoses des bébés, génitrices à l'époque d'une forte mortalité infantile. [...] Le couple infernal que forment [...] la triste et mauvaise année-récolte de 1630-1631 et, d'autre part, en conséquence de l'été chaud 1636, l'année dysentérique (et pesteuse) et ultrameurtrière pourrait ressortir, en termes climatico-démographiques de ce qui serait un modèle « froid et chaud » ou « frais et chaud », doublement mortel, du fait de la combinaison bipolaire (à quelques années de distance) de fraîcheurs humides excessives, puis de chaleurs très au-dessus des moyennes normales. On retrouvera un « duo » ou plutôt trio du même genre, mais avec des connotations beaucoup plus politiques et psychologiques cette fois, plutôt que démographiques, lors d'une « triplette » ultérieure, elle aussi dommageable, soit 1787-1788-1789, mêlant l'humide, le chaud-sec, la grêle et le glacial, le tout à des doses telles que la vie politique française, qui certes n'avait pas besoin de ça, en sera profondément affectée [...]
-
La méthode des scientifiques pour explorer le climat du passé est rôdée : ils creusent très profondément les étendues gelées de l’Antarctique ou du Groenland pour extraire des « carottes » glaciaires qui portent les traces des variations climatiques des derniers millénaires. Simple en théorie, mais délicat à mettre en oeuvre. C’est à plus de 1 000 km à l’intérieur du continent antarctique, à la base franco-italienne Concordia, que scientifiques et ingénieurs originaires de dix pays européens ont collecté des échantillons pendant huit ans, dans le cadre du projet Epica (European Project for Ice Coring in Antarctica). Leurs résultats, annoncés jeudi 10 juin en ouverture de la prestigieuse revue scientifique Nature, révèlent les secrets du climat des 740 000 dernières années. Cette étude nous apprend notamment que, durant les derniers 740 000 ans, la Terre a subi huit cycles climatiques, alternances de périodes glaciaires et de périodes plus chaudes. La période chaude la plus longue, qui a eu lieu il y a 420 000 ans, aura duré environ 28 000 ans. Puisque notre ère de réchauffement a commencé il y a seulement 10 000 ans, nous sommes donc encore au chaud pour 18 000 ans, en théorie. Mais en réalité, c’est bien le réchauffement, et non la glaciation, que les chercheurs redoutent. Car les analyses des bulles d'air emprisonnées dans la glace confirment que les teneurs actuelles en gaz à effet de serre atteignent le plus haut niveau jamais vu au cours des 440 000 dernières années. A cause de l’activité humaine, le réchauffement global n’a jamais été aussi rapide qu’aujourd’hui.
-
Les changements climatiques attendus sont déjà en train de se produire et il faut dès maintenant s'y adapter et prendre des mesures pour les réduire, ont affirmé des scientifiques. A l'occasion d'une réunion de la «American Association for the Advancement of Science», Chris Field, de l'Institut Carnegie de Washington, a déclaré que les changements climatiques auront des effets, sans l'ombre d'un doute. Nombre de scientifiques soutiennent que les différents gaz polluants émis dans l'atmosphère par les pays développés renforcent le phénomène d'effet de serre, provoquant une hausse des températures telle que les cultures en seront affectées à travers le monde. Le réchauffement devrait également provoquer une augmentation du niveau des océans, aggravant les inondations dans les régions côtières parmi les plus peuplées de la planète. Comme preuve de leur hypothèse, ils signalent que la température globale de l'atmosphère a augmenté en moyenne de 0,3 degré Celsius depuis un siècle.
-
AJACCIO, 15 juin 2004 (AFP) - Plus de 120 vacanciers ont dû être évacués lundi en fin d'après-midi de deux campings de la région de Calvi, après de violents orages qui ont provoqué d'importantes inondations sur cette micro-région de la Balagne, a-t-on appris mardi auprès des pompiers. Les personnes évacuées des deux campings situés en bord de mer par les pompiers épaulés par les soldats du 2e Régiment Etranger de Parachutistes (2e , ont été regroupées dans les locaux de groupes scolaires de Calvi. Les cours ont été annulés mardi dans les écoles qui servent d'abri. Les pompiers ont dû mener une centaine d'interventions, notamment pour des rez-de-chaussée d'habitations inondés. La RN 197 a dû être coupée à la circulation dans la soirée à la sortie nord de Calvi en raison des inondations et de coulées de boue. Selon le quotidien Corse-Matin, qui cite Météo-France, il est tombé près de 70 mm d'eau dans la région de Calvi entre 2h00 et 17h00 lundi, soit l'équivalent d'un bon mois de pluie.
-
Un autre article sur l'obscurcissement global...
-
BONN - Deux milliards de personnes dans le monde, en particulier en Asie, devraient vivre dans des zones menacées par les inondations en 2050. Les raisons: les changements climatiques et la croissance démographique, selon une étude des Nations unies. Les experts de l'Université des Nations unies (UNU) estiment qu'environ un milliard de personnes, soit un sixième de la population mondiale, vivent déjà dans des zones menacées de crues centennales. Ce chiffre pourrait doubler dans deux générations, quand la planète abritera dix milliards de personnes, si aucune mesure préventive n'est prise, prédit l'UNU. Selon l'UNU, qui ouvre mardi un nouvel institut spécialisé dans l'étude sur l'environnement et la sécurité humaine à Bonn en Allemagne, les zones à risques vont s'étendre en raison des changements climatiques, de la montée du niveau de la mer, de la poursuite de la déforestation en particulier dans les zones montagneuses, et à cause de l'attrait des zones inondables pour la richesse de leur sol. Le continent le plus en danger est l'Asie, théâtre de 44% des inondations mondiales entre 1987 et 1997. Elles y ont fait 228 000 morts et occasionné 113 milliards d'euros de dégâts, selon le directeur de l'Institut, Janos Bogardi. Mais «les inondations menacent l'existence même d'Etats dans d'autres parties du monde, les Etats insulaires comme les Maldives ou côtiers comme les Pays-Bas», a-t-il expliqué. La montée du niveau de la mer menace aussi les régions continentales, notamment en raison de crues des rivières plus graves, a-t-il ajouté, précisant que le nombre de cyclones et de tempêtes allait également augmenter avec le réchauffement de l'atmosphère. 14 jun 04
-
FUNAFUTI, Tuvalu (AP) -- Rivage grignoté, îlots engloutis, inondations... le réchauffement climatique lié aux gaz à effet de serre fait déjà planer une menace tangible pour les îles du Pacifique avec l'élévation du niveau de la mer. Les températures grimpent, les glaciers fondent, l'eau des océans monte et la menace climatique se précise. «Nous voyons peut-être déjà dans l'incidence accrue de la sécheresse, des inondations et des épisodes climatiques extrêmes (...) une partie des dévastations qui nous attendent», a averti en mars le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan. A cette occasion, il a appelé tous les Etats à ratifier le protocole de Kyoto conclu en 1997 pour réduire les émissions de «gaz à effet de serre» jugées responsables du réchauffement. Les Etats-Unis ont rejeté cet accord, au motif qu'il risquait de brider son moteur économique. Désormais seule sa ratification par la Russie peut relancer le traité, et l'année 2004 devrait être cruciale dans le débat sur la lutte contre le réchauffement. Sur le plan scientifique, les signes inquiétants s'accumulent. Le taux de dioxyde de carbone, qui est produit par la combustion des énergies fossiles, notamment par les voitures, a atteint un niveau record dans l'atmosphère l'hiver dernier, a rapporté en mars un observatoire d'Hawaï. En avril, des scientifiques américains ont annoncé, sur la base de relevés satellite de la Nasa, que la température moyenne à la surface de la terre avait augmenté de 0,43 degré entre 1981 et 1998. Ce qui renforce les résultats de relevés au sol, faisant état d'une élévation du mercure de 0,6 degré au 20e siècle. Ces chiffres vont également dans le sens de l'analyse du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), un organisme sous l'égide de l'ONU. Si les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas réduites rapidement, la température pourrait gagner 5,8 degrés d'ici la fin du siècle, avertit le GIEC. Si l'homme se décide à réagir face à la menace, la hausse pourrait être alors seulement de 1,4 degré, selon ces chercheurs. Le réchauffement pourrait changer le climat de régions entières et avoir de multiples effets comme des tempêtes plus violentes, une propagation de certaines maladies et une hausse du niveau des océans de 9 à 88 centimètres d'ici 2100, souligne le GIEC. L'élévation des océans est liée à deux facteurs: leur dilatation causée par le réchauffement et la fonte des glaces sur les continents. Le niveau des océans aurait gagné en moyenne 1 à 2 millimètres par an au cours du 20e siècle. Mais des satellites montrent que la hausse s'est «fortement accélérée» à 3 millimètres par an, souligne Walter Munk, de l'Institut d'océanographie Scripps à San Diego. Les habitants des îles du Pacifique ne sont pas les seules victimes potentielles du phénomène, qui représente également une menace pour de nombreuses populations dans le monde. Mais ils apparaissent particulièrement vulnérables. En outre, certaines îles de la région s'affaissent sous leur propre poids, ce qui aggrave leur situation. A Funafuti, un atoll à fleur d'eau, capitale de l'archipel des Tuvalu, la mer grignote le rivage et s'infiltre sous le sable pour créer de petits lacs dans les terres, et les fortes marées sont de plus en plus fréquentes, provoquant des inondations. Un îlot inhabité a même disparu sous les vagues. «Il a coulé lors d'un cyclone en 1997», selon le météorologue Hilia Vavae. Kiribati, un autre micro-Etat du Pacifique, a également perdu un îlot sur son principal atoll de Tarawa. A Majuro, la capitale des îles Marshall, la montée de la mer a déraciné des dizaines de cocotiers. A Kosrae, en Micronésie, «personne ne se souvient avoir vu des marées aussi fortes», note Simpson Abraham, un responsable local, et plusieurs îlots situés au large ont disparu. Aux Tuvalu (11.000 habitants), le Premier ministre Saufatu Sopoanga est en discussion avec la Nouvelle-Zélande, pour qu'elle accepte d'accueillir les habitants de l'archipel en cas de nécessité. «Dans 50 ou 100 ans, les Tuvalu devraient être submergées. Que pouvons-nous faire?», demande-t-il. AP
-
Ne trouvez-vous pas qu'il fait de plus en plus chaud sur Terre? Plus personne n'en est vraiment sûr, comme les résultats d'un congrès scientifique qui vient de se terminer lundi à Montréal le démontrent, puisqu'une nouvelle théorie accréditerait la thèse de la stabilisation ou du ralentissement du réchauffement planétaire: celle de l'obscurcissement global. À l'heure où Kyoto semble être devenu une priorité irréalisable pour bien des gouvernements de la planète, George W. Bush sera heureux d'entendre de la bouche de certains scientifiques qu'en réalité, la planète ne se réchauffe plus mais plutôt, se refroidit. C'est ce que les recherches de scientifiques ont conclu, dernièrement dévoilées à l'Assemblé Canado-Américaine de l'Union Géophysique à Montréal. Les scientifiques jugent que ce phénomène, appelé obscurcissement global, existe depuis les années '50 et qu'il a conduit à un affaiblissement des radiations des rayons solaires de 2 à 4% à chaque décennie. Cette théorie repose sur l'hypothèse vérifiée que la production de gaz à effet de serre et d'hydrocarbures n'a pas uniquement mené à une augmentation de dioxyde de carbone, mais aussi à une augmentation des particules qu'ils dégagent dans l'atmosphère. Cette augmentation de la température globale aurait donc pour effet d'évaporer les nappes d'eau et d'augmenter le nombre de nuages qui, combinés aux particules polluantes, rendraient les nuages plus opaques à la lumière et aux rayons du soleil, ce qui engendrerait un obscurcissement global générateur de refroidissement. Il semble que plusieurs preuves, autant au nord qu'au sud, démontreraient que l'évaporation des sols serait en ralentissement depuis 30 ans. Une thèse que peu osent affirmer avec certitude, si on considère que la glace au pôle nord est de plus en plus mince, que les réservoirs d'Hydro-Québec sont à sec et que la sécheresse dans certaines zones d'Afrique contraint les populations à la famine. On craint d'ailleurs, chez certains, que cette hypothèse vienne encourager les industries polluantes à ne rien faire ou faire le moins possible en matière de réduction d'émissions à effet de serre.
-
André Ciesielski Géologue Édition du jeudi 3 juin 2004 Les caprices du climat alimentent non plus la controverse mais la rumeur publique et, comme si ce n'était pas assez, voilà le cinéma hollywoodien qui s'en mêle. Le «réchauffement» de notre planète est passé rapidement de simple hypothèse à vérité médiatique. Et bien que cette hypothèse du «réchauffement anthropogénique» soit loin de faire l'unanimité, le débat sur le fond est escamoté, pour s'incarner dans une nouvelle vulgate météorologico-environnementale... On s'agite sans vraiment tenir compte des faits. S'agit-il d'un comportement rationnel ou d'une nouvelle mythologie? Plusieurs énoncés attestent de ce parti pris et font la une des médias. On lit souvent que le climat se «dérègle», comme si ce dernier avait été depuis toujours réglé par un deus ex machina, que la faible pluviométrie, le nombre plus grand de tempêtes, de tornades, d'ouragans, la plus grande variabilité du climat, l'augmentation des niveaux marins, les migrations animales ou, très récemment, l'extinction d'espèces sont liés au réchauffement de la planète. D'aucuns vont même jusqu'à tenter de nous apprendre comment «vivre les changements climatiques». En fait, il s'agit de contresens, de fausses prémisses ou de demi-vérités qui entretiennent la rumeur. Le climat a de tout temps varié et n'a jamais été réglé, puisqu'il s'agit d'un système chaotique que l'on prédit au mieux quelques jours à l'avance. Et il n'y a pas non plus d'évidence que la fréquence des phénomènes extrêmes, qui n'augmentent pas particulièrement, soit liée à un réchauffement anthropogénique. Quant à la pluviométrie, étant donné le budget hydraulique constant de la planète, les sécheresses sont répercutées par des inondations, sans lien direct avec la température, mais le plus souvent dues aux aménagements des fleuves. Les niveaux marins sont on ne peut plus stables depuis au moins un siècle et les habitats des espèces animales fluctuent naturellement, en partie liées aux variations régionales des températures. Quant aux extinctions actuelles de certaines espèces, seul l'homme en est responsable, et elles ont commencé bien avant le début du siècle dernier : le climat n'a rien à voir là-dedans ! Modèles prédictifs Toute la polémique est basée sur les mesures et les modèles prédictifs publiés par l'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Changes), qui mettent en évidence un réchauffement accéléré (0,5ûC depuis 1979) et, étant donné l'augmentation marquée du CO2 dans l'atmosphère, suffisant pour prédire une catastrophe calorique dans les décennies à venir. Soit, mais les mesures satellitaires et par ballon sonde ne confirment pas ce réchauffement au sol et les stations météorologiques non urbaines autour de la planète n'enregistrent pas non plus une augmentation marquée des températures. En fait, les mesures produites par l'IPCC reflètent principalement l'augmentation des températures mesurées par les stations (péri)urbaines, qui sont fortement biaisées par l'échange (nocturne) de chaleur des constructions (heat island effect). La réalité est qu'un système chaotique est en principe imprévisible [...]. Et prédire le climat demeure une entreprise redoutable à cause des nombreux paramètres et des incertitudes thermodynamiques (ex. : rapport entre -CO2 et température), mais aussi à cause de la difficulté de collecter et de valider les données. Peut-on imaginer un instant que la prise de mesures des températures peut être aussi efficace dans les pays où la population a peine à se nourrir, ou sur les océans, que dans les banlieues nord-américaines ? Dans l'histoire Les seules mesures fiables sont celles des satellites, et le réchauffement mesuré demeure encore près des variations naturelles. Les études paléoclimatiques suggèrent en effet un réchauffement actuel sur le long terme suivant le «Petit Âge glaciaire» (1215-1350) et Oscillation de Fernau (1590-1860), qui suivait lui-même un réchauffement marqué, soit «l'Optimum de l'An Mil» (ca. 800-1215), qui a provoqué une montée des forêts bien au-delà des limites septentrionales actuelles et permis aux Islandais d'Éric le Rouge de coloniser le Groenland («terre verte») et Terre-Neuve. Plus loin dans le temps, les études palynologiques suggèrent en outre un réchauffement très important en Europe du Nord vers 5000 av. J.-C., la phase Atlantique, permettant entre autres aux forêts caduques de coloniser la Scandinavie. Attribuer le faible réchauffement actuel à une cause anthropogénique devrait être basé sur beaucoup plus que des modèles, parce qu'à l'évidence, l'histoire géologique de la Terre n'est faite que de changements climatiques et des recherches suggèrent que beaucoup d'extinctions qui ont permis à l'homme d'aboutir et de se civiliser sont liées à ces mêmes changements, rendant les tentatives de nous apprendre à «vivre les changements climatiques» d'autant ridicules. En outre, les thuriféraires du réchauffement anthropogénique devront, en bons scientifiques qu'ils sont, expliquer les réchauffements antérieurs et ne pas s'en tenir à des données biaisées ou des demi-vérités, comme celle qui veut que ces dernières années ont été les plus chaudes du millénaire... Balivernes. Une analyse même succincte des données paléoclimatiques suffit à se convaincre immédiatement du contraire. Pour l'instant, les données suggèrent que les changements climatiques sont beaucoup plus liés aux cycles du rayonnement solaire qu'à quoi que ce soit d'autre, y compris la pollution humaine. Mais cette rumeur pourrait nous faire oublier que la lutte contre cette pollution atmosphérique et terrestre et ses causes est beaucoup plus importante que tous ces débats sur un réchauffement à venir et tous ces Kyoto qui ne servent à rien en définitive. Il est illusoire de vouloir diminuer la production de CO2 et de méthane sans remettre en cause le mode de développement qui le produit. Il s'agit d'un parti pris médiatique et politique qui vise à nous affranchir de notre responsabilité collective à maintenir un environnement décent en fabriquant un bouc émissaire : le «réchauffement global». On occulte ainsi les décisions environnementales souvent aliénées aux promoteurs, la politique des transports qui favorise l'automobile et l'étalement urbain, la surexploitation des océans (vous vous souvenez... la morue), des forêts (vous vous souvenez... les grands pins blancs) et des nappes phréatiques, les aménagements irréfléchis, le libéralisme outrancier et la mondialisation. Trop difficile, la remise en cause du mode de développement... Pratique, la rumeur. Ce sont nos petits-enfants qui vont être contents.
-
Directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace et président de l'Institut polaire Paul-Emile Victor, Jean Jouzel est membre du bureau du GIEC. Leader scientifique du programme européen de forage en Antarctique, il est directeur de recherche au CEA (Commissariat à l'énergie atomique) et vient de publier le Climat: jeu dangereux (1). Il cosigne, avec 55 autres auteurs européens, un article paru aujourd'hui dans la revue Nature. Quelle leçon tirez-vous de l'étude des 740 000 dernières années de climat réalisée grâce aux forages des glaces de l'Antarctique ? Le résultat le plus spectaculaire, et le plus instructif pour notre avenir climatique, porte sur la période chaude, située il y a 400 000 ans. Les astronomes nous l'avaient signalé: il s'agit de la phase la plus similaire à celle que les hommes connaissent depuis 10 000 ans, l'holocène. Du moins pour les relations entre le Soleil et la Terre, première cause de variation du climat. Mais nous manquions de données précises sur sa durée et, surtout, sur l'évolution de l'effet de serre lors de cette période. Les glaces de l'Antarctique nous disent que cette phase a duré 28 000 ans, contre 15 000 maximum pour les trois interglaciaires qui ont suivi. Elles nous montrent aussi un effet de serre remarquablement stable, avec un gaz carbonique à 280 parties par million (ppm) et le méthane à 680 parties par milliard (ppb) dans l'atmosphère. La Terre d'aujourd'hui était donc partie, naturellement, vers un climat stable pour près de 20 000 ans encore, comme le suggéraient les calculs de l'astronome André Berger. Sauf que nous avons explosé le compteur des gaz à effet de serre. La teneur en gaz carbonique est déjà passée de 280 à 370 ppm depuis la révolution industrielle. Et le méthane a grimpé de 650 à 1 750 ppb. Plus grave : si nous persistons à augmenter nos émissions par l'usage massif du charbon, du gaz et du pétrole comme par la déforestation nous pourrions atteindre près 1 000 ppm de CO2 en 2 100. A la stabilité promise par la nature, nous substituons, ce faisant, le risque d'une excursion brutale, instantanée à l'échelle géologique, dans un climat inconnu sur Terre depuis des millions d'années. Que peut-on dire de certain sur le climat futur si les émissions de gaz à effet de serre continuent de croître ? L'analyse de la recherche mondiale menée sur le sujet par le GIEC permet de dégager des points importants. Les incertitudes initiales, il y a quinze ans, se sont estompées. S'y nous n'y prenons pas garde, nous provoquerons un réchauffement d'environ 3 °C à l'horizon 2 100. C'est la valeur moyenne des simulations informatiques nous permettant d'explorer les conséquences de nos émissions, les valeurs extrêmes montant à près de 6 °C. Cette moyenne masque des variations bien plus brutales. De 4 à 5 °C sur l'Europe, mais de 8 °C à 10 °C sur les hautes latitudes nord, les océans se réchauffant moins vite. L'Europe du Nord serait affectée de pluies surabondantes l'hiver, tandis que le pourtour méditerranéen subirait des sécheresses accrues l'été. Inondations pour les villes du Nord, pénurie d'eau, source de conflits géopolitiques, au sud. Une hausse de 50 cm des océans concernerait par ailleurs directement 200 millions de personnes. Une hausse pratiquement irréversible et qui se poursuivra plusieurs siècles au même rythme. La fonte accélérée des glaciers continentaux modifiera le régime des fleuves. La biodiversité souffrira en raison de la rapidité des changements. Nous pouvons donc, en un demi-siècle, enclencher un bouleversement climatique majeur, irréversible, dont les conséquences pèseront sur nos petits-enfants. Où se situent les principales incertitudes des scientifiques ? L'amplitude et le rythme du réchauffement demeurent dans une fourchette de deux ou trois degrés pour un même scénario d'émission de gaz à effet de serre. Et il reste très délicat d'explorer les dimensions régionales du changement. La variabilité climatique, donc la fréquence des événements extrêmes, semble devoir augmenter, mais nous avons du mal à la quantifier. De même pour la fréquence des cyclones. Les précipitations, comme les régimes de mousson, résistent à la simulation, alors qu'il s'agit de paramètres décisifs pour l'agriculture et la sécurité alimentaire. Les modes climatiques El Niño, l'oscillation Nord-Atlantique sont encore mal compris. Or, ils affectent l'économie, l'agriculture, les pêches... En outre, on ne peut écarter de bonnes ou de mauvaises surprises. Un effet atténuateur nous a peut-être échappé. Inversement, on peut craindre que le cycle du carbone change et libère massivement du gaz carbonique dans l'atmosphère. Ou que du méthane piégé dans le pergélisol (sol gelé en permanence, ndlr) soit brusquement relâché, emballant l'effet de serre. Nous travaillons d'arrache-pied pour réduire ces incertitudes. Mais il ne faut pas attendre pour agir, en raison de l'inertie du système climatique. Dans cinquante ans, il sera trop tard. Pour éviter un dérapage, à quel niveau devons-nous limiter nos émissions de gaz à effet de serre ? La Convention climat de l'ONU, signée et ratifiée par de nombreux Etats, stipule qu'il faut stabiliser l'effet de serre. Nous ne pouvons plus nous fixer pour objectif de le réduire à son niveau préindustriel. Ni d'éviter tout changement climatique. Un niveau de 450 ou 500 ppm de gaz carbonique, qui pourrait limiter le réchauffement à environ 2 °C, semble un objectif réaliste. Il exige néanmoins que les émissions mondiales culminent à 12 milliards de tonnes de carbone en 2020, contre 8 aujourd'hui. Puis qu'elles redescendent au niveau actuel en 2 040 pour terminer le siècle à 2 milliards. Il suffit de comparer ces chiffres aux 25 à 30 milliards couramment évoqués par les prospectivistes pour 2 100 pour mesurer l'effort à accomplir. Cet effort doit commencer dès maintenant dans les pays riches principaux pollueurs historiques si l'on veut y rallier dans l'avenir des pays en voie de développement qui ont un besoin crucial d'énergie pour sortir des milliards de gens de la pauvreté. Que penser du film The Day After ? Le scénario de ce film catastrophe suppose un réchauffement produisant une glaciation aussi violente que rapide, avec l'image de New York englacée. C'est spectaculaire mais peu réaliste. L'arrivée d'eau douce en abondance sur l'Arctique et l'Atlantique Nord, par les pluies et les fleuves, qui déclenche ce scénario, est certes prévue par les simulations numériques du climat à l'horizon 2 100. Mais si ce phénomène ralentit le Gulf Stream, donc diminue l'apport de chaleur tropicale aux hautes latitudes, il ne débouche en aucun cas sur une glaciation. Même dans ces conditions, l'Europe de l'Ouest et du Nord serait bien plus chaude qu'aujourd'hui. (1) De Jean Jouzel et Anne Debroise. Dunod, coll. Quai des sciences. 224 pp., 19 euros.
-
Si l'on en croit les travaux de chercheurs de l'Université de Berne, le réchauffement actuel de la planète devrait se maintenir durant au moins 15 000 ans. C'est le résultat d'extrapolations réalisées à partir de carottes de forage provenant des vieilles glaces de l'Antarctique, dont l'analyse est publiée cette semaine dans la revue scientifique "Nature". L'histoire du climat de la Terre se dévoile dans une carotte de glace de trois kilomètres de long, a expliqué mercredi l'Université de Berne. Cette glace s'est formée par les chutes de neige tombée durant les 740 000 dernières années et constitue aujourd'hui la plus ancienne description ininterrompue du climat terrestre. Cette analyse couronne un projet de recherche mis sur pied par dix pays européens sur le Dôme C, dans la partie orientale de la calotte glaciaire antarctique. L'analyse confirme que les 740 000 dernières années ont connu huit périodes glaciaires, durant lesquelles le climat a été beaucoup plus froid qu'aujourd'hui. Elles ont alterné avec huit périodes chaudes qui, durant les 400 000 dernières années, ont connu des températures comparables à celles d'aujourd'hui. Ces intervalles cléments n'ont pas été très chauds mais ont duré plus longtemps que les périodes froides. En comparant les données climatiques anciennes avec celles d'aujourd'hui, les chercheurs bernois en déduisent que la période chaude actuelle devrait durer encore 15.000 ans au moins, abstraction faite des interventions humaines. De petites bulles d'air ont été extraites des carottes afin d'évaluer dans quelle mesure la composition de l'atmosphère a changé. Les analyses ont montré que la concentration en gaz carbonique durant les 440 000 dernières années n'a jamais été aussi haute qu'aujourd'hui. Les chercheurs espèrent arriver à de meilleures prévisions climatiques en identifiant les paramètres qui déterminent un passage d'une période à l'autre. Les carottes glaciaires ont été prélevées sur le Dôme C dans le cadre du Projet européen pour des forages glaciaires en Antarctique (EPICA). L'opération s'est déroulée par des températures estivales de -40 degrés Celsius, à plus de 1 000 kilomètres de la station de recherche la plus proche. Le consortium EPICA va poursuivre les forages profonds en décembre, dans l'espoir d'atteindre le plancher rocheux situé sous la croûte de glace. Il ne lui manquerait qu'une centaine de mètres. Si tout se passe selon les prévisions, les chercheurs vont disposer d'archives climatiques glaciaires s'étendant sur plus de 900 000 ans.
-
2003, année record pour les températures à La Réunion 12 juin 2004 "Globalement, 2003 est l’année la plus chaude que la Réunion ait connu depuis que l’on y mesure régulièrement la température. Elle dépasse en cela l’année 1998, qui fut déjà particulièrement chaude", affirme Météo France. Notre pays n’échappe pas à un phénomène mondial qui dominera ce siècle. Dans un communiqué de presse publié hier, les services de Météo-France à La Réunion affirment que l’an dernier, "à Gillot, la température moyenne annuelle a atteint 24,52°C. C’est la plus forte valeur observée depuis l’ouverture de la station en 1953. Il en est ainsi pour de nombreux points de mesures, tels La Plaine des Cafres dans les Hauts (1.560 mètres d’altitude) avec une moyenne annuelle de 14,15°C. On remarque par ailleurs, à Gillot, que cinq années (2003, 1998, 2001, 1994 et 2002), au cours de la dernière décennies, figurent parmi les plus chaudes depuis 1953". Météo-France ajoute que "la chaleur a, d’ailleurs, été l’un des éléments marquants de la saison chaude de novembre 2002 à avril 2003. Elle a été omniprésente, et de nombreux records sont tombés, tant au niveau des températures minimales que maximales". Faute de pouvoir entrer dans le détail, Météo-France se contente de citer deux chiffres : les 36,9°C enregistrés au Port le 25 février 2003, soit le record absolu de température maximale observé à La Réunion depuis que l’on dispose de mesures régulières, et - finalement peut-être encore plus impressionnants - les 36,0°C enregistrés à cette même station du Port le 8 avril 2003. Records de températures maximales La saison chaude 2003-2004, n’a rien à envier à la précédente, avec des températures supérieures. En effet, écrit Météo-France : 29,2°C à Saint-Pierre Ligne Paradis en novembre, 29,9°C à Saint-Benoît en décembre et 33,2°C à l’Étang-Salé les Bains en janvier établissent de nouveaux records de moyennes de températures maximales. Mais, affirme Météo-France, "c’est surtout en février et mars 2004 que la chaleur devient de plus en plus accablante, suite à des températures nocturnes particulièrement élevées". Et de préciser : 29,0°C à l’Etang-Salé les Bains, 28,2°C au Port, 28,1°C à Gillot sont les minimales les plus élevées enregistrées en février, depuis l’ouverture de ces stations. Les maximales ne sont d’ailleurs pas en reste, avec 33,4°C à Menciol, 28,8°C à La Plaine des Palmistes en février, et, en mars, 36,9°C au Port, qui égale le record de l’année précédente, 35,3 °C à Pont Mathurin, 28,5 à La Plaine des Palmistes ; ce sont les nouveaux records de températures maximales pour un mois de mars. Avril 2004, avec des températures moyennes supérieures aux normales, est cependant moins chaud qu’en 2003. Mettre en œuvre la loi Vergès Les services météorologiques signalent par ailleurs qu’en France, la moyenne des températures exceptionnellement chaudes de 2003 égale le record précédemment établi en 1994 avec 13,0°C (moyenne calculée à partir des températures de 22 stations sélectionnées, une par région économique). Cette valeur constitue le record de température moyenne observé sur la France depuis 1950. Il est bon de rappeler à ce propos que le plan "Vigilance canicule", dans le cadre la convention "Urgences climatiques" applicable en Métropole, ne s’étend pas actuellement à La Réunion. Dans le monde, l’année 2003 se situe au 3ème rang, pour les températures moyennes observées les plus élevées. Voir à ce sujet l’article paru hier dans “Témoignages”. En tout cas, on voit à travers les chiffres cités par Météo-France à La Réunion que notre île est concernée comme le reste de la planète par les changements climatiques. Les effets du réchauffement de la Terre seront parmi les phénomènes les plus marquants de notre vie quotidienne au cours de ce siècle. D’où la nécessité de mettre en œuvre la loi de Paul Vergès sur la “priorité nationale” de ce problème et le protocole de Kyoto pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. D’où l’importance de mettre en œuvre un développement durable et de prévenir les effets des changements climatiques.
-

Appel à la vigilance incendies dans le Var
Nyko a posté un sujet dans Météo, environnement et société
TOULON (Reuters) - La préfecture du Var a lancé vendredi un appel à la vigilance en raison d'un risque accru d'incendies dans lesmassifs de l'Estérel, des Maures et de la Sainte-Baume. "Les prévisions de Météo France font apparaître une évolution défavorable de la sécheresse entraînant une sensibilité accrue de lavégétation arbustive, et donc des risques d'incendie", précise-t-elle dans un communiqué. Un important dispositif de prévention a été mis en place, avec notamment le déploiement de 12 groupes de sapeurs-pompiersauxquels s'ajoutent des patrouilles forestières, de police et de gendarmerie. Parallèlement, six Canadairs et un Tracker ont été placés en alerte sur la zone. Le préfet du Var appelle à la "vigilance et au respect des consignes simples" pour permettre d'éviter la "moindre étincelle pouvantgénérer une catastrophe". Globalement, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur connaît un déficit pluviométrique important depuis le mois de février, avec enmoyenne des pluies inférieures de 15% à la normale. Reuters , vendredi 11 juin 2004, 23h04 -

Le tourisme breton dopé par l'effet de la canicule
Nyko a posté un sujet dans Météo, environnement et société
BREST (AFP) - Un an après la canicule, les professionnels du tourisme de la pointe de la Bretagne espèrent fidéliser les vacanciers en quête de "fraîcheur" qui fuient les fortes chaleurs du Sud ou du Centre de la France pour trouver refuge sur les côtes tempérées du Finistère. "La canicule a constitué une bonne campagne promotionnelle pour la destination Bretagne jusqu'à la pointe", note Anne Coutière, de l'Observatoire du tourisme breton, qui a chiffré à un million de nuitées supplémentaires les réservations de dernière minute ou les allongements de séjours consécutifs à la canicule d'août 2003. S'il s'avère difficile d'anticiper cet "effet canicule" sur la réalité des réservations, les professionnels ont d'ores et déjà relevé des signes encourageants. "On a affaire à de nouvelles clientèles venant de la région PACA et encore plus de la Région Rhône-Alpes", constate le comité du tourisme du Finistère, qui insiste sur les demandes de renseignements précoces, "25 à 30 % de plus en janvier et février". "On a gagné en notoriété", se félicite le gérant d'un camping de Bénodet qui a bouclé en février, avec un mois et demi d'avance, les réservations pour ses bungalows, confirmant que "la météo de l'été précédent conditionnait souvent les réservations de l'année suivante". Mêmes constatations à Crozon où l'on évoque "un véritable engouement dans les réservations surtout jusqu'aux vacances de Pâques", selon Chrystelle Le Bris, de l'Office de Tourisme, qui a noté de nombreux appels du Sud. "Quand ils avaient l'accent, on les questionnait et tous nous parlaient de la météo", ajoute-elle amusée et un peu agacée par la question qui revient souvent, "quel temps fera-t-il chez vous cet été ?". Au camping des Pins de Crozon, Marie-Claire Le Brun se réjouit de l'arrivée de ces touristes "qui ont découvert la Bretagne sous le soleil" et qui en "redemandent". Dans cette presqu'île jamais avare d'une petite pointe de vent salvatrice, on se rappelle du défilé des vacanciers en quête de fraîcheur. "On ne pouvait satisfaire à la demande... On refusait des familles entières qui repartaient vers les terres. Du jamais vu", se rappelle la gérante du camping. Aujourd'hui, ses bungalows affichent complet en juillet et août. "On aurait pu en louer trois fois plus!", précise-t-elle. "Beaucoup sont venus sans connaître la Bretagne, c'est une nouvelle clientèle intéressante à fixer", poursuit Loïg Roudaut, patron du camping de la plage de la Grève Blanche, sur la côte Nord, dans le port goémonier de Plouguerneau, face au phare de l'Ile Vierge, le plus haut d'Europe. En août dernier, Loïg se rappelle bien de ces vacanciers qui avaient "fui" selon leurs propres mots, les chaleurs accablantes du Centre. Outre son climat tempéré, la Bretagne bénéficiera cette année pour le seul mois de juillet, en plus des festivals traditionnels, des manifestations "Brest et Douarnenez 2004" pour les amoureux du patrimoine maritime et du passage du Tour de France à Quimper. La météo restant par nature évolutive, l'optimisme des professionnels reste pondéré: "Il suffit d'un été pluvieux pour tout remettre en cause", constatent-ils. -

La sécheresse menace plusieurs régions de France
Nyko a posté un sujet dans Météo, environnement et société
Face aux récents pics de température, la vigilance reste de mise en France où la sécheresse menace le Nord, l'Est et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le ministère de l'Environnement surveille de près les ressources en eau. "La vigilance est de rigueur. L'Est, le Nord et PACA sont dans une situation de sécheresse relative", déclare-t-on au ministère de l'Environnement . Dans le reste du pays, les ressources en eau sont jugées assez satisfaisantes, même si des mesures anticipant une éventuelle sécheresse sont mises en place depuis avril. En Champagne-Ardenne, en Lorraine, en Alsace, en Bourgogne, en Franche-Comté et dans le Nord-Pas-de-Calais, le niveau des ressources en eau est à l'inverse jugé "inquiétant". "Les réserves en eau sont plus basses que d'habitude dans ces régions. C'est inquiétant. On continue de faire attention. On craint une sécheresse dans ces zones", souligne-t-on au ministère. Les pics de chaleur enregistrés ces derniers jours ont aggravé la situation, provoquant une évaporation de l'eau en surface, ce qui risque d'être préjudiciable aux cultures. Dans la région PACA, où les sols sont particulièrement secs, des incendies sont à craindre, souligne le ministère de l'Environnement. Selon Météo France, depuis lundi les températures ont atteint des valeurs "élevées pour un début juin" sur quasiment toute la France, dépassant 30°C dans toute la région Nord. Le ministère rappelle toutefois que Météo France prévoit pour les prochains jours une baisse du mercure. Dans son bulletin de jeudi, le météorologiste explique que cette hausse de température "peu fréquente, mais pas exceptionnelle", ne signifie pas que l'été 2004 sera "particulièrement chaud". "Ainsi, l'été 1996 n'a pas été singulièrement chaud, alors que début juin, Météo France avait relevé partout en France des températures supérieures à 30°C avec des pointes à 34°C dans la capitale, valeur qui n'a plus été atteinte de l'été", rappelle-t-il. Du côté de la FNSEA, on souligne que "le temps change vite". "On passe du chaud au froid. Il est trop tôt pour parler de sécheresse et de canicule", a dit à Reuters Jean-Michel Dalmas, chargé des questions des calamités et assurance-récoltes à la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. "On observe certes des déficits en eau dans certaines régions. On reste vigilant et attentif", a-t-il ajouté. "Ce que l'on craint surtout, ce sont les pics de chaleur. Cela crée une évaporation abondante de l'eau en surface, ce qui provoque un besoin d'irrigation des plantes", a-t-il souligné. Des instructions ont d'ores et déjà été données aux préfets pour prendre des mesures de restrictions d'usage de l'eau, en cas de sécheresse. "Dans certains départements, tous les dispositifs d'actions sont prêts", confirme-t-on au ministère de l'Environnement. -
Il a neigé vers la Ballon d'Alsace, TF1 a montré aux infos quelques images à 13H
-
Le préfet de la Meuse a réuni les maires, les responsables des syndicats des Eaux et les ceux des collectivités de tout un secteur de la Meuse, jeudi, pour étudier les mesures à envisager devant un inquiétant manque d'eau, apprend-on auprès de la préfecture, vendredi. Il n'a guère plu sur ce département depuis le mois de décembre. La pénurie touche d'ores et déjà 33 communes et 6.300 habitants. Le marie de Varennes-en-Argonne a pris en début de semaine un arrêté municipal de restriction d'utilisation de l'eau (arrosage des pelouses, lavage de voiture, remplissage de piscine...). L'eau de trois citernes (en tout 78.000 litres) doit compléter chaque jour le déficit du réservoir principal qui alimente Varennes et trois communes proches, représentant 1.700 habitants. Les captages directs et provisoires à partir de rivières locales sont envisagés. Source: AP
-

Lyon touchés par la neige
Nyko a répondu à un sujet de boubou69 dans Prévisions à court et moyen terme
Méteo-consult : ne pas trop faire confiance sur leur prévision... -
/emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">/emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">/emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
-
J'ai une petite question qui me vient à l'instant à l'esprit: y'a t'il ou y'a t'il eu dans le passé une station météo au sommet de la Tour Eiffel??? Merci de votre réponse... /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20">
-

Du nouveau sur Montpellier, MF voit pluie samedi
Nyko a répondu à un sujet dans Prévisions à court et moyen terme
De la puie sur Montpellier -

plus de neige annoncé en valée du rhone sur le val
Nyko a répondu à un sujet dans Prévisions à court et moyen terme
Il veut dire que la météo n'annonce plus de neige dans le vallée du Rhône -
Demande à aveyron12, il habite vers Rodez, il te renseignera