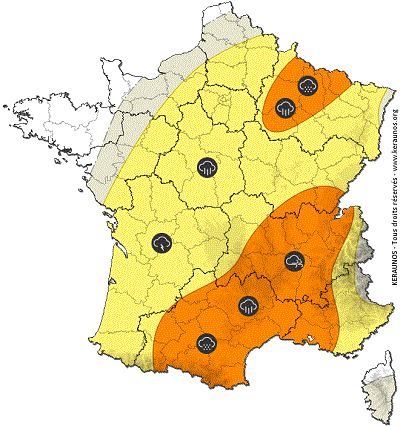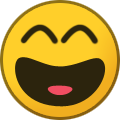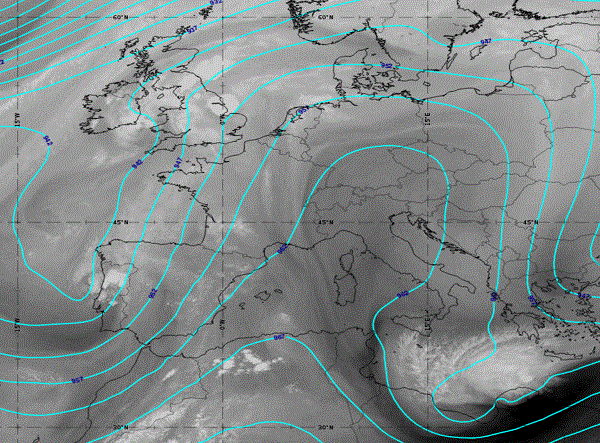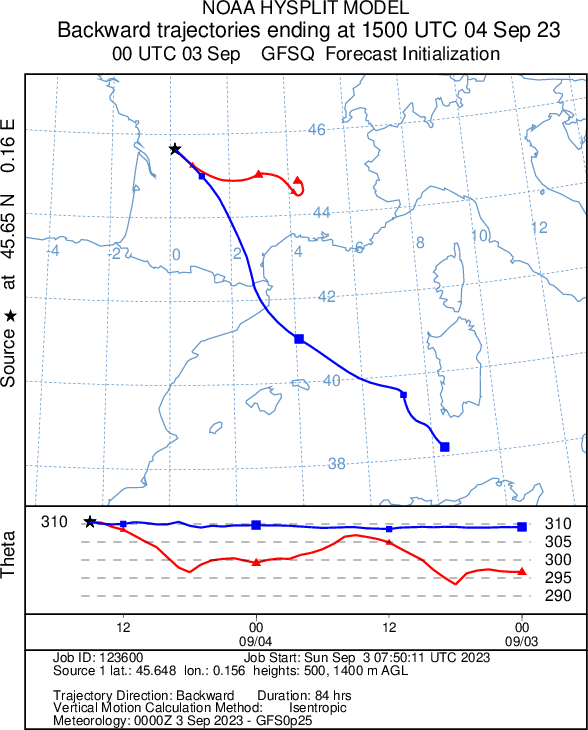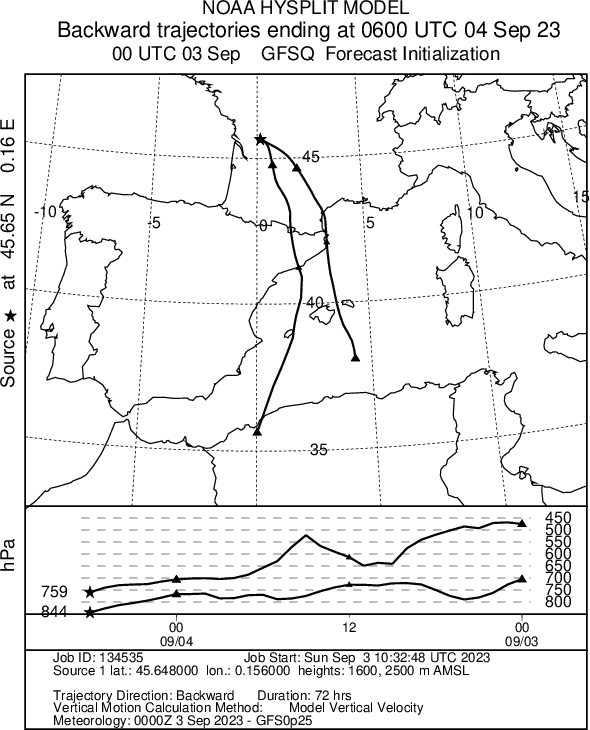Cers
Membres-
Compteur de contenus
4161 -
Inscription
-
Jours gagnés
4
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Cers
-
Suivi du temps dans le Nord Est - Septembre 2023
Cers a répondu à un sujet de Spring dans Le temps en France
Il a plu sans discontinuer pendant plus une demi-heure (averse stationnaire). A présent, l'intensité de pluie diminue. -
Du 18 septembre au 24 septembre 2023 - Prévisions météo semaine 38
Cers a répondu à un sujet de Nico 14 dans Evolution à plus long terme
Et la theta-E, c'est quoi ? Cela a été rappelé à maintes reprises, mais comme tu es nouveau sur le forum à priori, je le répète pour toi (et d'autres qui n'auraient pas compris) : une carte de GFS ou tout autre modèle déterministe à 240 ou 300 h en prévision du temps, çà ne vaut rien car la prévisibilité devient trop faible, donc il ne sert à rien de commenter çà dans ce topic. A cette échéance, il faut exploiter les produits de la prévision d'ensemble, regarder des probabilités par exemple, ou des champs moyens avec les écart-types... Il y a un topic des souhaits en revanche, où tu peux partager tes rêves, tes envies.- 21 réponses
-
- 18
-

-

-

-

-

-
Suivi des fortes et très fortes chaleurs tardives de l'été 2023
Cers a répondu à un sujet de Matpo dans Climatologie
Ne tenant pas forcément compte des choix et définitions de Météo-France, la qualification de vague de chaleur reste appropriée pour cet événement. Je comprends qu'il faille des critères/seuils néanmoins, et ceux-ci différent suivant les organismes ou pays. Comment sont obtenus ces critères statistiques chez MF, notamment la valeur d'ITN à deux décimales ?- 193 réponses
-
- chaleur tardive
- canicule
-
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
-
Suivi du temps dans le Nord Est - Septembre 2023
Cers a répondu à un sujet de Spring dans Le temps en France
Visiblement, c'est sur l'axe Thuilley-aux-Groseilles - Maron que les plus forts échos ont été observés. -
Suivi du temps dans le Nord Est - Septembre 2023
Cers a répondu à un sujet de Spring dans Le temps en France
C'est ce qu'on peut appeler un manqué : l'orage de nature supercellulaire en Côte-d'Or, observé entre deux zones à risque orageux fort par Keraunos. -
Suivi du temps dans le Sud-Ouest - Septembre 2023
Cers a répondu à un sujet de pim82 dans Le temps en France
Je peux comprendre ton mécontentement, mais je trouve également les commentaires un peu durs. Premièrement car il y avait bien un potentiel orageux après 17 h sur le 65, me semble t-il. Et le département a bien été partiellement touché en soirée. Deuxièmement car tu ne tiens pas compte de l'incertitude spatio-temporelle associée au développement des orages dans une zone donnée. Si j'avais organisé à l'avance une randonnée de montagne entre 17 h et 21 h hier dans ton secteur, compte tenu de la possibilité d'orage, j'aurais certainement pris la décision de l'annuler / la reporter (indépendamment des décisions de MF). -
Suivi du temps dans le Nord Est - Septembre 2023
Cers a répondu à un sujet de Spring dans Le temps en France
Ah, mais il ne s'agit pas de sondages à proprement parler, il n'y a pas observations in-situ en altitude dans la zone. Keraunos ne communique pas beaucoup sur ses produits hélas, mais sur la carte dont tu parles, la CAPE entre autres est juste déduite des données modèles les plus récentes (leur WRF peut-être) dont celles en surface sont corrigées par les observations des stations, pour obtenir des valeurs plus proches de la réalité à un instant donné. Par exemple, si la température et le point de rosée à 2 m diffèrent de la prévision, çà se répercute sur la CAPE. -
Suivi du temps dans le Nord Est - Septembre 2023
Cers a répondu à un sujet de Spring dans Le temps en France
Salut, quel sondage ? -
Je peux de te conseiller des lectures (en français si tu ne maitrises pas l'anglais) éventuellement. Mais hélas tu comprendras que je ne peux pas répondre à toutes tes nombreuses questions par MP ou ici, ni t'aider individuellement et gracieusement. Surtout, il faut d'abord faire l'effort individuel de comprendre les bases, lire et apprendre dans des manuels ou via des ressources en ligne avant de se lancer directement dans des annales/questionnaires à choix multiples. Comprendre la météo, cela prend du temps !
-
Suivi du temps dans le Nord Est - Septembre 2023
Cers a répondu à un sujet de Spring dans Le temps en France
T'es déjà revenu ? La pause aura été de courte durée. Dix à quinze jours de vacances après des années d'observations sans relâche, c'était mérité. -
Du 04 septembre au 10 septembre 2023 - Prévisions météo semaine 36
Cers a répondu à un sujet de faycal dans Evolution à plus long terme
Je ne savais pas où montrer cette figure. Il s'agit simplement des isohypses en haute troposphère superposées à l'image vapeur d'eau à 17 h (source Eumetrain). On devine encore la configuration synoptique en oméga, avec un thalweg de part et d'autre d'une dorsale en Europe centrale. La dépression à l'origine de conditions météorologiques perturbées en Méditerranée vers la Grèce est bien visible. De notre côté, l'Europe de l'Ouest entre graduellement sous l'influence du thalweg atlantique, lequel va progresser lentement vers l'est en début de semaine. La figure met en évidence un écoulement de secteur SO plus ou moins instable entre la péninsule Ibérique et les îles Britanniques ce dimanche après-midi. Voyez en particulier l'initiation de la convection humide profonde au nord du Portugal, juste en aval du thalweg alors associé à un axe de plus forte vorticité cyclonique (liée de la courbure importante et au cisaillement horizontal de vent dans cette zone). Le transport de tourbillon cyclonique renforce les mouvements ascendants et favorise les orages. L'image WV révèle aussi notamment la présence d'un système convectif à l'est de l'Angleterre ou du Royaume-Uni, où l'environnement s'avère propice aux orages aujourd'hui. Ce soir et la nuit prochaine, des orages pourraient affecter le golfe de Gascogne, l'Aquitaine et le centre-ouest. -
Du 18 septembre au 24 septembre 2023 - Prévisions météo semaine 38
Cers a répondu à un sujet de Nico 14 dans Evolution à plus long terme
Salut Nico. Si je peux me permettre, et ce n'est pas adressé spécifiquement à toi, je lis souvent "la barocline" sur le forum. C'est pas forcément inexact, mais à mon avis dans ce contexte il serait plus rigoureux d'écrire quelque chose comme : "la zone barocline de grande échelle pourrait s'abaisser en latitude", ou encore "la baroclinicité atmosphérique pourrait augmenter à nos moyennes latitudes", si j'ai bien compris le sens de ton message. De cette façon, il y a moins de confusion possible, en tout cas je pense. -
Prévisions Sud-Ouest - Septembre 2023
Cers a répondu à un sujet de neige84 dans Prévisions à court et moyen terme
Par rapport à la prévision AROME à 13 h, les observations à Bordeaux montrent une MUCAPE équivalente (proche de 1400 J/kg) mais déjà une inhibition convective plus faible pour les parcelles d'air les plus instables, ce qui peut avoir une incidence sur l'initiation des orages plus tard. On peut voir en effet la différence de profil en basses couches entre l'observation (première figure) et la prévision (seconde figure) en tout début d'après-midi ce dimanche : l'EML est un peu altérée, l'inversion thermique observée apparaît moins marquée que celle prévue, le tout conjugué à une surface plus chaude (notez le gradient sur-adiabatique tout près du sol). Cela se traduit par une inhibition convective moindre. Par contre, la couche limite est plus sèche, la MLCAPE est bien faible, mais de toute façon la MLCIN apparaît trop forte pour être vaincue et donc la MLCAPE être utilisée. On retrouve par ailleurs le backing sur le profil de vent, puis la rotation à droite au-dessus de 2 km environ. En altitude, au-dessus d'une couche plus humide vers 700 hPa, on observe de l'air sec entre 400 et 650 hPa. -
Prévisions Sud-Ouest - Septembre 2023
Cers a répondu à un sujet de neige84 dans Prévisions à court et moyen terme
L'ouest de la France est sous l'influence d'un thalweg synoptique peu mobile situé sur le proche-Atlantique. Dans le courant de secteur sud, des advections chaudes continuent de se produire et circulent des thalwegs de courte longueur d'onde associés à du soulèvement et de la convergence dans les niveaux inférieurs, favorisant la convection profonde. L'analyse du champ de vorticité à 500 hPa sur IFS montre en particulier un transport de vorticité cyclonique entre le sud de l'Espagne et le centre-ouest de la France d'ici la nuit prochaine, à l'origine d'advection différentielle de vorticité cyclonique. Le champ de div (Q) montre aussi une zone de convergence (forçage pour des mouvements ascendants). La masse d'air chaud et humide est caractérisée à 850 hPa par des theta-W de 16 à 19 °C, alors que de l'air plus sec et plus frais circule en altitude vers 500-600 hPa, à l'origine d'un gradient vertical de température pseudo-potentielle du thermomètre mouillé négatif et donc d'instabilité convective. Des orages devraient se déclencher cet après-midi au nord de l'Espagne, remonter dans le courant de sud-sud-ouest, et concerner notamment le golfe de Gascogne et la façade atlantique en soirée et la nuit prochaine. Le sondage de Bordeaux la nuit dernière montrait un gradient vertical de température plutôt élevé au-dessus de la couche limite nocturne. Les sondages prévus ce soir en Aquitaine montrent une EML à l'étage moyen, des gradients thermiques verticaux assez forts entre la surface et 700 hPa (~ 8 K/km en moyenne). La MUCAPE excèdera potentiellement 1 kJ/kg, en particulier près des littoraux, soit une instabilité modérée. Les profils verticaux montrent néanmoins une MUCIN parfois importante, supérieure à 50-100 J/kg, qui devra être érodée par les forçages verticaux pour être vaincue et autoriser une convection humide profonde. Si initiation il y a, compte tenu d'un cisaillement vertical de vent profond modéré - entre 20 et 35 kts -, des clusters multicellulaires seront possibles. Un orage de grêle est envisageable (grêlons de 5-15 mm voire 2-3 cm localement). La présence d'air sec en moyenne troposphère, les profils en V inversé associés à une DCAPE > 1000 J/kg suggèrent par ailleurs la possibilité, localement, de forts vent convectifs (potentiel qui dépendra en partie de la stabilisation de la couche limite). On le voit, bien que la probabilité d'orage soit plus élevée en mer, un orage fort n'est pas à écarter près des côtes d'Aquitaine. En début de semaine, le thalweg d'échelle synoptique va gagner vers l'est et un écoulement rapide en altitude s'installera entre l'est de l'Espagne et le sud de la France d'ici mardi. Les régions du sud-ouest seront sous l'influence d'un courant de secteur sud-ouest divergent en altitude. Par rapport à ce weekend, les profils verticaux se déstabiliseront davantage à l'intérieur des terres de lundi à mardi. Des valeurs de MUCAPE entre 1000 et 2000 J/kg sont attendues. La MLCAPE pourrait même atteindre ou dépasser 1000 J/kg. A nouveau, des orages se développeront lundi après-midi en Espagne puis probablement par le sud de l'Aquitaine et aux abords, dans un environnement instable et bien convergent en basses couches. Le cisaillement vertical de vent serait à priori trop faible pour autoriser des supercellules, mais suffisant pour permettre le développement de structures multicellulaires potentiellement bien actives. La probabilité d'orage multi-modèles en Aquitaine et à l'ouest de Midi-Pyrénées est en tout cas élevée lundi soir entre 16 h et 21 h UTC. Des orages fortement électriques sont envisageables. L'atmosphère sera dotée d'un contenu en eau précipitable de 30 à 40 mm. Les orages pourront se montrer très pluvieux et localement producteurs de grêle. Le risque de vents forts sera surtout conditionné par l'organisation de la convection, les orages pouvant évoluer en un système convectif de méso-échelle pluvio-venteux remontant dans l'écoulement de sud-ouest en direction du Limousin. Mardi, des orages se formeront à nouveau et concerneraient davantage l'Occitanie par rapport à la veille, tandis que l'atmosphère deviendra peu à peu moins instable en allant vers le littoral atlantique. -
Salut @Lachignole, merci de l'intérêt porté à mon blog. L'étude de cas sera publiée après la vague de chaleur actuelle. J'ai commencé à travailler sur les figures et l'analyse. Je posterai le lien vers l'article ici lorsqu'il sera en ligne. Adrien
-
Prévisions Centre-Ouest septembre 2023
Cers a répondu à un sujet de Lodu17 dans Prévisions à court et moyen terme
Les modèles de prévision du temps ne tiennent pas toujours compte des variations de concentrations d'aérosols désertiques. A la fin de cet article, j'en parle brièvement : https://www.meteopratique.com/2022/04/sable-du-sahara.html?m=1 -
Suivi du temps dans le Sud-Ouest - Septembre 2023
Cers a répondu à un sujet de pim82 dans Le temps en France
L'évolution du profil vertical est notable sur 24 heures à Bordeaux entre dimanche et lundi à mi-journée. En comparant, on voit d'abord dans la couche [500, 1000] hPa le décalage de la courbe d'état (en rouge) vers la droite et le décalage de la courbe du point de rosée (en vert) vers la gauche, traduisant un réchauffement et un assèchement de la masse d'air par les processus de transport et de subsidence. La hauteur de la tropopause, identifiable par l'inversion de température au-dessus de 200 hPa, augmente pour atteindre plus de 14 km d'altitude ! L'isotherme 0 °C, déjà relativement haut, passe de 4434 m à 4675 m. Le profil de dimanche en basse couche (au-dessus) montre une couche de mélange (gradient adiabatique sec de 1 K pour 100 m) diurne surmontée par une inversion vers 1 km d'altitude. Ce lundi (au-dessous), l'inversion était plus marquée et l'épaisseur de la couche de mélange près de la surface encore plus restreinte, suite au réchauffement par advection et subsidence de l'air. La température potentielle croît avec z, on note trois couches de mélange élevées (EMLs), caractérisées chacune par un gradient thermique adiabatique sec. Ceci résulte des advections d'air chaud et sec originaire d'Afrique du Nord, où les couches de mélange peuvent être très profondes, avec une température potentielle supérieure à 40 °C. D'ailleurs, sur ce sondage, theta ~ 40 °C entre 700 et 850 hPa, soit davantage que la veille. La subsidence peut aider un maintenir de forts lapse rates. Comme l'air est très sec, la CAPE est nulle. -
Bon, l'article reviendra aussi sur la vague de chaleur de ce début septembre, tant qu'à faire !
-
Prévisions Centre-Ouest septembre 2023
Cers a répondu à un sujet de Lodu17 dans Prévisions à court et moyen terme
Bonjour, Par curiosité, j'ai regardé quelques trajectoires ce matin avec le modèle HYSPLIT de la NOAA, à partir des données GFS. Je vous en montre quelques unes. J'ai choisi la position d'Angoulême comme point d'arrivée, où il est prévu pas loin de 39 °C sous abri lundi après-midi, une température extrême pour début septembre. Tout d'abord, voici la trajectoire de deux parcelles arrivant au-dessus d'Angoulême lundi matin à 6 h UTC. On voit que l'air provient d'Afrique du Nord et de Méditerranée, où l'air est plus chaud. Sur le graphe en bas à gauche, c'est la pression atmosphérique. Lire le diagramme de droite à gauche. Les parcelles d'air, lors de leur déplacement vers le nord, sont animées en moyenne d'un mouvement descendant. Lorsque l'air descend, il y a un réchauffement adiabatique dû à la compression, et assèchement de la masse d'air. Notez au passage l'influence des Pyrénées pour la parcelle d'air la plus élevée passant au-dessus de la montagne : ce dimanche après-midi l'air monte en amont du relief dans un courant de sud puis redescend côté français (on retrouve bien cet effet en coupe verticale). Pour les deux autres figures présentées plus bas, j'ai sélectionné les deux niveaux d'arrivée suivants, lundi à 15 h UTC : 500 m et 1400 m et au-dessus du sol, il s'agit des trajectoires représentées en rouge et en bleu respectivement, commençant le 3/09 à 00 UTC. En regardant d'abord la carte, on note que l'air vers 850 hPa lundi à 17 h dans l'ouest de la France proviendra de Méditerranée, des environs de la Sardaigne : il y a un transport entre l'Afrique du Nord et la France, comme déjà montré plus haut. Mais dans la couche limite de surface, des parcelles d'air proviendront du sud-est du Massif central en effectuant alors un trajet plus court dans le même laps de temps. Sur le graphe en bas à gauche, c'est la pression atmosphérique. Lire le diagramme de droite à gauche. La parcelle d'air remontant de Méditerranée (en bleu) évolue entre 800 et 880 hPa avant d'atteindre l'ouest de la France lundi à 852 hPa. Sur le graphe de droite, c'est la température potentielle, theta. La température potentielle est par définition la température qu'aurait une parcelle d'air si elle était ramenée adiabatiquement au niveau standard 1000 hPa. Pour obtenir la theta d'une parcelle d'air située à un niveau P donné à l'aide d'un diagramme thermodynamique, c'est simple, il suffit de suivre la courbe adiabatique sèche en partant de la température T jusqu'à 1000 hPa. La theta est indépendante de l'humidité et caractérise la température d'une parcelle d'air indépendamment des variations de pression : une parcelle d'air qui du point de vue de la température vraie T (celle qu'on mesurerait) se réchauffe adiabatiquement en descendant par exemple conserve sa température potentielle. Theta ne peut changer que s'il y a apport ou perte de chaleur via les échanges avec l'extérieur ! Son évolution nous renseigne alors sur les sources/puits diabatiques. Revenons à notre parcelle d'air dont la trajectoire est représentée en bleu : sa température potentielle est de 309 K initialement au voisinage de la Sardaigne et de 310 K à l'arrivée, elle ne change pas beaucoup au cours du déplacement. Il y a dans ce cas quasi-conservation de la température potentielle, ce qui indique que la parcelle d'air, assez éloignée de la surface, n'a en fait quasiment pas reçu de chaleur. Mais 310 K de theta soit ~ 37 °C, c'est élevé ! En considérant un gradient adiabatique sec en basse couche et sur-adiabatique près du sol, cela correspond bien à une température de 39 °C à 2 m et de 23 °C environ à 850 hPa (le sondage prévu par GFS est montré en bas). Par conséquent, entre ce dimanche et lundi après-midi, l'augmentation de température à 850 hPa est liée à une advection chaude. Intéressons-nous maintenant à la parcelle d'air dont la trajectoire est représentée en rouge, près de la surface. Initialement le 3/09 à minuit, elle se situe en Ardèche vers 920 hPa (graphe de la figure de gauche). On voit que l'air descend la nuit vers la vallée du Rhône, la pression augmente (puisque P diminue avec z). Puis la parcelle d'air subit en journée une ascension sur le Massif central tout en se dirigeant vers l'ouest. Elle redescend du côté ouest du Massif central lundi pour atteindre finalement Angoulême. Observons l'évolution de la température potentielle (graphe de droite). Initialement, la theta est de 296 K : cette parcelle en France est donc potentiellement plus froide au départ que celle de tout à l'heure. Cependant, contrairement à la parcelle d'air précédente, la theta augmente significativement entre dimanche et lundi ! Ce qui signifie, si vous avez bien suivi, que notre parcelle a gagné de l'énergie. Et cette énergie provient tout naturellement du Soleil : chauffage radiatif. Le sol se réchauffe en journée et la couche limite se réchauffe par turbulence. Notre parcelle gagne d'abord de l'énergie dimanche : sa température potentielle grimpe de 294 K (~ 21 °C) à 306 K (~ 33 °C) l'après-midi. Suite au refroidissement nocturne, sa theta diminue puis remonte encore lundi jusqu'à 310 K (~ 37 °C) dans l'ouest suite au chauffage diurne. Cette brève analyse montre le rôle conjugué de l'advection chaude, du chauffage radiatif et de la subsidence synoptique dans le réchauffement atmosphérique.- 67 réponses
-
- 11
-

-

-

-
Prévisions Sud-Ouest - Septembre 2023
Cers a répondu à un sujet de neige84 dans Prévisions à court et moyen terme
En fin d'après-midi et ce soir, un thalweg d'altitude franchira les Pyrénées et pourrait favoriser une convection profonde et orageuse du massif pyrénéen à l'Aquitaine. On peut voir ce thalweg secondaire à 300 hPa ou 500 hPa (ci-dessous), remontant vers le sud-ouest de la France, alors qu'un cut-off low peu mobile évolue au large de la péninsule Ibérique, induisant des mouvements verticaux synoptiques. Le minimum dépressionnaire se prolonge en surface dans l'air chaud sur l'Espagne, légèrement décalé par rapport à la dépression d'altitude, signature d'un système actif. Le champ d'épaisseur [500-1000] hPa (couleurs) indique la présence d'une masse d'air chaud sur la France. A 300 hPa, le thalweg est associé à du fort tourbillon cyclonique (en rouge ci-dessus, juste au sud des Pyrénées). Le transport de vorticité positive par le vent de composante sud se traduit par une advection de vorticité absolue positive en aval du thalweg. L'advection de vorticité cyclonique augmente avec l'altitude, en raison du cisaillement vertical de vent (lequel croît avec Z) et parce que le thalweg est plus prononcé près de la tropopause que dans les niveaux inférieurs (tourbillon cyclonique plus fort). Par conséquent, l'advection différentielle de vorticité cyclonique est prévue positive : AVA(300 hPA) - AVA(700 hPa) > 0. Ceci contribue à générer des ascendances ; le diagnostic peut être effectué à partir de la convergence des vecteurs Q à 500 hPa : div Q < 0 (en rouge) => forçage pour des ascendances. Dans un environnement encore instable (CAPE entre 500 et 1500 J/kg), des orages seront alors possibles. Ils seraient plus ou moins bien organisés. Le cisaillement vertical de vent entre la surface et 6 km est montré sur la dernière figure : 40-70 km/h de SE, soit autour de 15 m/s en module, ce qui pourrait permettre quelques orages multicellulaires. -
Du 04 septembre au 10 septembre 2023 - Prévisions météo semaine 36
Cers a répondu à un sujet de faycal dans Evolution à plus long terme
Ce ne serait pas une joie... Mais il ne te reprendra plus, puisqu'il n'interviendra plus. -
Prévisions Sud-Ouest - Septembre 2023
Cers a répondu à un sujet de neige84 dans Prévisions à court et moyen terme
@DoubleKnacki "D'ailleurs Cers si tu passes par là, j'ai toujours un doute sur cette identification au niveau de cette configuration du jet dans ce genre de cas de figure. Pour moi, ça ressemble à une petite tentative de cassure passagère, plaçant l'Ouest aquitaine dans une sortie de SG/ED de jet fortement divergente. Néanmoins, il n'y a pas vraiment non plus de cassure à proprement parler. On dirait que le système orageux qui remonte par le Sud au même moment, provoque une sorte de fracture temporaire au sein du courant jet, sauf que je n'en suis pas certain. Si tu as une explication, que je puisse rectifier le tir de mon côté" @ORAGE31 "la présence de fortes ascendances synoptiques en ED de jet comme tu dis. D'ailleurs, en regardant le champ de divergence à 300hPa sur GFS, on peut voir un fort noyaux de divergence sur l'Aquitaine." Le développement des orages est étroitement relié à la configuration synoptique et à des facteurs à l'échelle méso. Il convient d'avoir aussi à l'esprit que les orages modifient l'environnement au sein duquel ils éclatent. Des ascendances et une divergence du vent en haute troposphère peuvent résulter de la convection profonde elle-même. Il n'y a pas de divergence en entrée droite ou sortie gauche de jet streak favorisant la convection dans le sud-ouest de la France ce soir. Un jet-streak circule au large de la Bretagne, et l'entrée droite associée à un forçage QG pour des ascendances se situe un peu en marge, plus à l'ouest au niveau de la zone frontale, au large entre la péninsule Ibérique et les côtes atlantique en fin d'après-midi (figure ci-dessous). L'advection différentielle de vorticité cyclonique dans le sud-ouest de la France est limitée ; on a en revanche une advection chaude dans les niveaux inférieurs (deuxième figure) -> forçage pour des ascendances et participe à la déstabilisation des profils verticaux ou la diminution de la CINH. Les ascendances dans les systèmes convectifs sont compensées par des mouvements descendants et conjuguées à un écoulement divergent en altitude, au niveau des sommets/enclumes à l'équilibre thermique (typiquement au voisinage de la tropopause). Si la divergence à 300 hPa ne précède pas les orages, ce n'est pas un forçage. Sur les cartes AROME, on voit souvent se développer une forte diffluence suite au déclenchement de la convection dans le modèle, c'est l'effet de la convection sur l'écoulement. Le vent près de la tropopause se renforce souvent dans la zone avant gauche d'orages organisés à méso-échelle (apparition d'un maximum de vent), où le courant dû à l'outflow divergent vient s'ajouter au courant général de même direction. De plus, le chauffage lié à la libération de chaleur latente au sein de l'atmosphère a pour effet de changer la répartition du champ de vorticité potentielle (PV). Il y a création d'un dipôle vertical (pouvant être plus ou moins incliné dans un environnement cisaillé en profondeur) caractérisé par une anomalie de PV+ au-dessous de la zone de chauffage diabatique, et une anomalie de PV- juste au-dessus. Ce qui tend à renforcer le gradient horizontal de PV près de la tropopause et le courant de haute altitude. Sur la coupe ci-dessous, la tropopause dynamique est plus haute au-dessus des ascendances, et on visualise un maximum local de PV à mi-troposphère (~ 2 PVU). Bref, c'est complexe, mais il faut retenir que (1) les orages se développent et s'organisent si les ingrédients requis - humidité, instabilité convective, forçages à méso-échelle, cisaillement vertical de vent - sont réunis, (2) les caractéristiques de l'atmosphère influencent leur évolution et que (3) ces orages affectent leur environnement (modifications des champs de température, vent, géopotentiel, tourbillon...), à l'échelle locale, puis ces changements se répercutent avec le temps à plus grande échelle en fonction de l'ampleur de la convection. Si des éléments météorologiques identifiés comme résultant de la convection profonde ne sont pas des forçages, ils peuvent néanmoins influencer l'initiation/le développement d'autres orages (et donc devenir des forçages...). -
Le prochain article portera sur la vague de chaleur récente, qui a été exceptionnelle : processus physiques menant aux épisodes de chaleur, particularités météo de l'événement du 16 au 24 août dernier, observations/records et changement climatique. Bonne soirée
-
Citer ses sources : utilité ou non?
Cers a répondu à un sujet de Turquoise_ExNico41 dans Questions - réponses sur la météo
La question était de savoir en quoi citer la/les source(s) est important, non ? Sur les réseaux sociaux, les publications ne sont pas accompagnées de bibliographie que je sache. Ce qui ne signifie pas qu'on peut se dispenser de la source lorsqu'on montre une figure, par exemple. -
Citer ses sources : utilité ou non?
Cers a répondu à un sujet de Turquoise_ExNico41 dans Questions - réponses sur la météo
Citer la ou les source(s), c'est d'abord respecter le droit d'auteur, reconnaitre et ne pas s'approprier le travail d'autrui, c'est faire preuve d'éthique. Cela permet également de justifier des propos et d'appuyer son argumentation, de donner éventuellement de la crédibilité, d'apporter de la valeur. Un lecteur ou une lectrice intéressé(e) peut aller consulter les sources, pour en vérifier la fiabilité ou en savoir plus sur un sujet.